La tension est montée d’un cran entre Alger et Bamako après un incident militaire à la frontière. Derrière ce bras de fer, se dessinent des enjeux régionaux majeurs. Décryptage en cinq questions.
1. Qu’est-ce qui a déclenché la crise entre l’Algérie et le Mali ?
Le 1er avril 2025, l’armée algérienne annonce avoir abattu un drone militaire venu du Mali dans la région de Tinzaouatine, dans l’extrême sud du pays, à la frontière avec le nord malien. Ce drone, selon Alger, violait son espace aérien. L’incident, discret au départ, prend rapidement une dimension politique : l’Algérie y voit une provocation inacceptable.
Le Mali, lui, ne confirme ni n’infirme officiellement l’incursion, mais quelques jours plus tard, l’Alliance des États du Sahel (AES) — composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger — annonce le rappel de ses ambassadeurs en poste à Alger. L’Algérie réagit à son tour en fermant son espace aérien aux avions maliens et en convoquant son propre ambassadeur à Bamako.
2. Pourquoi les relations entre l’Algérie et le Mali sont-elles déjà fragilisées ?
Historiquement, l’Algérie joue un rôle clé de médiateur dans le conflit malien. Elle est le principal artisan de l’Accord d’Alger de 2015, signé entre le gouvernement malien et des groupes armés du nord, notamment touaregs. Mais depuis la prise du pouvoir par une junte militaire à Bamako en 2021, ces accords sont de plus en plus remis en cause.
En janvier 2024, les autorités maliennes annoncent le retrait du processus de paix, accusant l’Algérie de “connivence” avec certains groupes rebelles du nord. Le gouvernement de transition à Bamako, très critique vis-à-vis des puissances étrangères et résolument tourné vers Moscou, considère désormais l’Algérie comme un acteur biaisé. Alger, de son côté, garde des liens avec les mouvements touaregs, qu’elle voit comme des interlocuteurs nécessaires pour stabiliser sa propre frontière sud.
3. Pourquoi la fermeture de l’espace aérien est-elle symboliquement forte ?
Le 7 avril, l’Algérie décide de fermer son ciel aux vols maliens, une mesure rare entre deux pays voisins non engagés dans un conflit direct. Officiellement, la télévision publique algérienne justifie cette décision par la “récurrence des violations de l’espace aérien”.
Symboliquement, cette décision traduit une rupture grave du dialogue. D’autant que l’Algérie entretient des liens commerciaux et humanitaires importants avec le nord du Mali, notamment avec les régions de Kidal et de Gao, historiquement proches du sud algérien. Le trafic aérien — militaire comme civil — est vital pour ces zones enclavées. Sa suspension aggrave un isolement déjà critique.
4. Qu’est-ce que cela révèle sur les rapports de force au Sahel ?
La crise entre Alger et Bamako illustre une recomposition profonde du paysage régional. Le retrait de la France et de la mission onusienne MINUSMA a laissé un vide sécuritaire que les États sahéliens tentent de combler eux-mêmes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé l’AES, un bloc militaire et politique tourné vers l’autonomie stratégique — quitte à se couper de certains partenaires traditionnels.
L’Algérie, puissance régionale qui s’est toujours tenue à l’écart des alliances militaires étrangères, se retrouve aujourd’hui isolée diplomatiquement face à des voisins dirigés par des régimes militaires, parfois hostiles à son influence. Ce climat alimente la méfiance et accroît les risques de confrontations indirectes, notamment via des groupes armés opérant dans les zones grises du Sahel.
5. Quelles conséquences pour la stabilité de la région ?
Les répercussions pourraient être sérieuses. D’abord sur le plan sécuritaire : une rupture de coopération entre Alger et Bamako affaiblit la lutte contre les groupes djihadistes actifs dans le nord du Mali, le sud algérien et le Niger. Ensuite sur le plan humanitaire : les populations civiles, notamment dans les régions de Kidal ou Ménaka, risquent de se retrouver encore plus isolées.
Sur le plan diplomatique, cette crise pourrait enterrer durablement les Accords d’Alger, déjà moribonds. Elle complique aussi les efforts de dialogue dans une région fragmentée, où les alliances sont mouvantes et la défiance généralisée.
En coulisse, certains observateurs redoutent une montée progressive vers une forme de “guerre froide sahélienne”, où s’opposeraient des blocs aux visions antagonistes de la souveraineté, de la sécurité et des relations internationales.

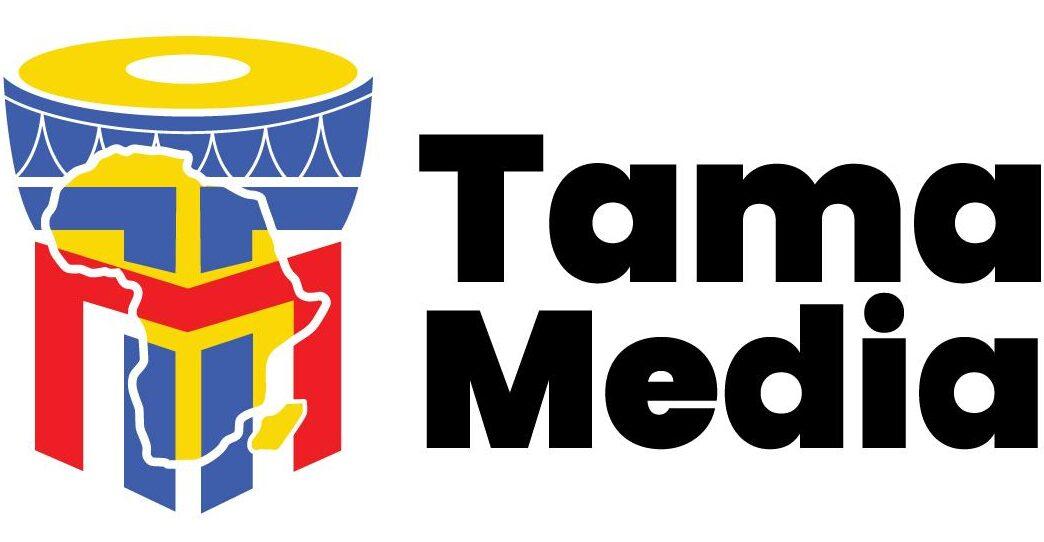

![[Tribune] - La question du Franc CFA : un débat mal posé 2 La question du Franc CFA : un débat mal posé](https://tamamedia.com/wp-content/uploads/2025/04/franc-cfa-afrique.jpg)


