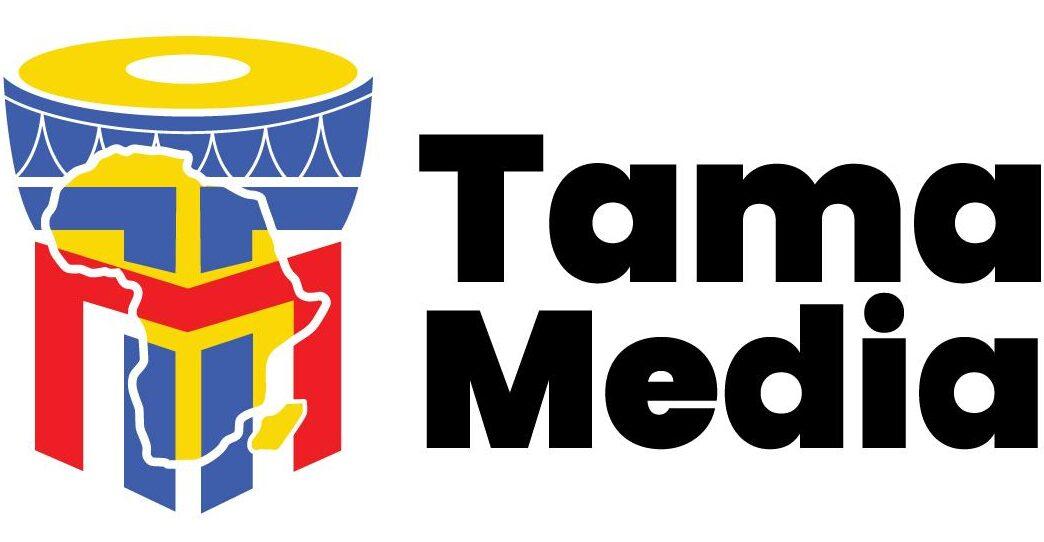La reine Elizabeth II, monarque la plus célèbre de la planète, est décédée jeudi à 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés, et son fils le prince Charles lui succède automatiquement.
“La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain”, a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni où Elizabeth II était très populaire.
Au Kenya, Elizabeth s’est couchée princesse et s’est réveillée reine
C’est au Kenya que la vie d’Elizabeth a basculé: la princesse s’offrait une expérience unique d’observation de la vie sauvage depuis la cime des arbres, au coeur du massif des Aberdare, quand la mort de son père a été annoncée.
La nouvelle est tombée au matin du 6 février 1952. Le roi George VI avait succombé pendant la nuit à un cancer du poumon à Sandringham House, une des résidences de la famille royale dans l’est de l’Angleterre.
L’information mettra une journée de plus pour traverser l’épaisse forêt des Aberdare, à 7.000 kilomètres de là, et atteindre sa fille de 25 ans, héritière au trône.
La princesse Elizabeth était en visite au Kenya, alors colonie britannique, dans le cadre d’une tournée dans le Commonwealth, à la place de son père malade.
Avec son mari, le prince Philip, elle s’était accordée une nuit loin de ses obligations officielles pour séjourner à Treetops, un pavillon d’observation de la faune unique en son genre, perché au sommet d’un figuier géant.
Cet épisode a été évoqué par une formule attribuée à Jim Corbett, le naturaliste et chasseur qui accompagnait le couple royal à Treetops, dans le livre d’or de l’établissement: “Pour la première fois dans l’histoire du monde, une jeune fille monta un jour dans un arbre en tant que princesse et, après avoir vécu ce qu’elle a décrit comme son expérience la plus excitante, elle est descendue de l’arbre le lendemain en étant reine”.
“Expérience formidable”
En réalité, Elizabeth n’a appris la nouvelle qu’après son départ de Treetops, mais l’Histoire a retenu que c’est dans ce lieu qu’une princesse est devenue reine.
Ouvert en 1932, Treetops était un lieu unique, juché dans le feuillage d’un figuier surplombant un point d’eau, qui offrait aux riches visiteurs une vue imprenable sur la faune.
Elizabeth et Philip ont fait un décompte manuscrit des animaux observés sur une feuille de papier encadrée à l’intérieur de Treetops: troupeaux d’éléphants -“environ 40” en une seule observation-, babouins, cobes à croissant, “des rhinos toute la nuit”, peut-on notamment lire dans cet inventaire daté du 5-6 février 1952.
Un assistant du couple royal, chargé d’envoyer une lettre de remerciement aux propriétaires de l’hôtel, a décrit une “expérience formidable d’observation de la faune sauvage dans son environnement naturel” et une journée et une nuit “pleines d’intérêt”.
“Je suis tout à fait certain que c’est l’une des expériences les plus merveilleuses que la reine ou le duc d’Édimbourg aient jamais vécues”, peut-on lire dans cette lettre datée du 8 février 1952, également encadrée à Treetops.
Retour en 1983
Deux ans après cette visite, Treetops a brûlé dans ce qui fut présenté comme un incendie criminel des rebelles anti-coloniaux Mau Mau.
Un nouvel établissement, beaucoup plus grand, a été construit sur pilotis de l’autre côté du point d’eau, où il se trouve encore aujourd’hui.
Qu’importe, la visite royale -et la légende qui l’accompagne- ont fait rentrer Treetops dans l’Histoire.
Les invités pouvaient séjourner dans la suite Princess Elizabeth, parcourir les souvenirs royaux dans la salle à manger ou contempler un portrait de la reine encadré par les deux défenses d’un éléphant abattu dans les années 1960.
Elizabeth et Philip y sont revenus en 1983, dans des tenues plus formelles: robe jusqu’aux genoux pour la reine, blazer et cravate pour le prince.
Treetops a fermé ses portes au début de la pandémie de coronavirus et n’a pas rouvert depuis.
Deux ans plus tard, après le décès de sa plus illustre cliente, il apparaît désormais comme un vestige lointain d’une époque révolue.