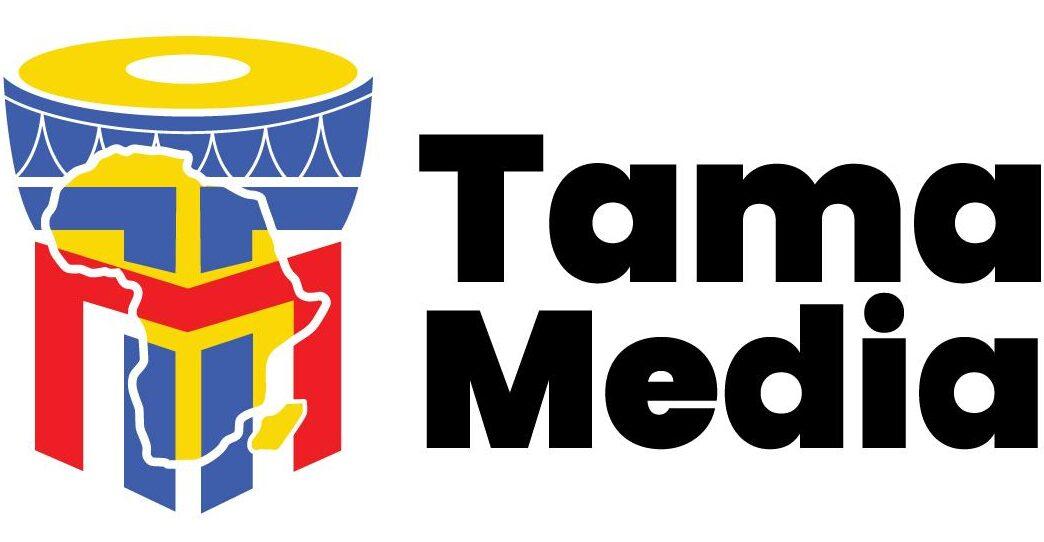Le 28 février 2004, lors de la deuxième session extraordinaire de l’Union africaine à Syrte, en Libye, l’organisation panafricaine a adopté la politique africaine commune de défense et de sécurité qui vise à consolider une architecture de défense continentale capable de faire progresser la paix et la sécurité en faisant face aux menaces intérieures et extérieures. Bien qu’il s’agisse d’un instrument essentiel, la « Common African Defence and Security Policy » (CADSP) n’a pas eu une grande attention de la part des politiques et des universitaires.

« La politique africaine commune de défense et de sécurité reste essentielle dans la dynamique actuelle de la sécurité pour plusieurs raisons. Tout d’abord, son principe fondamental est « l’indivisibilité de la sécurité en Afrique », qui stipule que « la sécurité d’un pays africain est indissociable de la sécurité des autres pays africains et du continent africain dans son ensemble ».
La création de l’Union africaine (UA) en 2002 a marqué un nouveau chapitre dans les efforts du continent en faveur de la sécurité collective. L’impératif d’une politique de défense commune fait partie intégrante de la création de l’UA, comme le stipule son acte constitutif. Le protocole du Conseil de paix et de sécurité adopté la même année a réaffirmé la nécessité de cette politique et a défini les principaux piliers de l’architecture africaine de paix et de sécurité (APSA). Après la création de l’UA, plusieurs normes et mécanismes historiques en matière de gouvernance, de paix et de sécurité ont été élaborés, ce qui lui a permis de jouer un rôle beaucoup plus proactif dans la prévention et la gestion des conflits sur le continent que son prédécesseur, l’Organisation de l’unité africaine (OUA).
20ème anniversaire de la CADSP
La CADSP est l’expression de l’action de l’Afrique en faveur de la sécurité collective et plaide en faveur de réponses globales et fondées sur des principes en matière de paix et de sécurité. Bien que la politique n’aborde pas en détail les menaces émergentes et non traditionnelles qui sont plus importantes dans le paysage actuel de la sécurité mondiale et régionale, elle adopte une approche holistique en définissant la sécurité et la défense au-delà de la dimension militaire.
Il y a près de 20 ans, l’ambassadeur Omar Touray, ancien représentant permanent de la Gambie auprès de l’UA et actuel président de la commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a noté que la CADSP « représente la détermination des dirigeants africains à prendre en charge l’agenda de la paix et de la sécurité ». Aujourd’hui, cette détermination est mise à rude épreuve par de multiples défis, bien qu’il soit clairement reconnu que l’intérêt supérieur de l’Afrique est servi par sa recherche collective de la paix et de la sécurité, en particulier à un moment où « l’Afrique est au cœur des tempêtes géopolitiques ».
Principaux éléments de la CADSP
La CADSP complète le protocole du Conseil de paix et de sécurité (CPS) en servant de cadre continental essentiel pour renforcer la sécurité collective en coordonnant les efforts de défense et de sécurité des États africains. Elle définit environ 25 objectifs ambitieux, notamment l’élimination des rivalités entre les États, la promotion de la coopération et de l’intégration régionale, et la mise en place d’un cadre pour l’établissement et l’opérationnalisation de la Force africaine en attente (FAA).
Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) est spécifiquement chargé de mettre en œuvre la politique sécurité, tandis que la politique africaine commune de défense et de sécurité (CADSP) réaffirme la primauté du rôle de l’UA dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Bien que le Conseil de paix et de sécurité n’ait pas tenu de délibérations régulières sur l’opérationnalisation de la CADSP, il s’est penché sur les défis croissants posés par la prolifération des armées étrangères en Afrique, qui sapent les mécanismes continentaux.
L’un des principaux éléments constitutifs de la CADSP est la formation d’un mécanisme de défense continental sous la forme d’une force africaine en attente (FAA). L’absence d’un accord multilatéral solide en matière de sécurité collective, la lenteur de la mise en œuvre d’outils continentaux tels que la FAA et les besoins immédiats des États en matière de sécurité ont accru le recours à des coalitions ad hoc qui se situent en dehors de la structure de sécurité multilatérale formelle. La FAA a été déclarée pleinement opérationnelle en 2015 et à nouveau en 2020 lors du sommet extraordinaire de l’UA sur le thème « Faire taire les armes » qui a également chargé le CPS d’autoriser et de soutenir les coalitions ad hoc.
Toutefois, le déploiement effectif de la FAA n’a pas encore eu lieu. Il est de plus en plus reconnu que la FAA doit s’adapter au paysage sécuritaire actuel et à l’évolution de la dynamique. Cela est d’autant plus important que les arrangements ad hoc et les déploiements menés par les communautés économiques régionales (CER) ont montré une plus grande flexibilité avec laquelle les États africains peuvent déployer des forces pour répondre à l’insécurité. Cependant, ces déploiements, tout en comblant le vide sécuritaire, peuvent également risquer d’éroder les efforts multilatéraux continentaux, étant donné que certains d’entre eux ont été déployés sans la consultation ou l’autorisation préalable nécessaire du CPS. Les cas dans la région de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et les déploiements au Mozambique et en République démocratique du Congo (RDC) reflètent cette réalité.
Comme les OSP dirigées par l’UA ont diminué au cours des dix dernières années, les communautés économiques régionales (CER) ou les alliances d’États membres ont été plus actives dans le déploiement de troupes sur le terrain. Sur le plan normatif, l’UA est reconnue comme l’acteur principal du maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. Le CPS a souligné à juste titre que la FAA (Force africaine en attente) est « le principal modèle local sur le continent, pour permettre à l’Afrique de renforcer ses arrangements en matière de défense et de sécurité » et il a appelé les États membres à renouveler leurs engagements envers la CADSP et la FAA.
Il est essentiel de prendre en compte les implications de ces forces sur le développement et la consolidation de l’architecture de sécurité panafricaine et sur la stabilité à long terme du continent. La façon dont les décideurs associent pragmatisme et flexibilité d’une part, et normalisent les réponses ancrées dans les principes multilatéraux d’autre part, déterminera la durabilité et l’efficacité des efforts de paix et de sécurité. À cet égard, la CADSP, tout en reconnaissant le rôle des acteurs sous-régionaux à travers les politiques et les efforts déployés dans la gestion des conflits, met l’accent sur la paix et l’intervention autour du mandat de l’UA et du CPS. Plus particulièrement, elle souligne le rôle de l’UA dans la coordination des mécanismes sous-régionaux et l’engagement de ces mécanismes à harmoniser leurs efforts avec ceux de l’UA.
Pourquoi le respect des principes de la CADSP reste pertinent ?
1- L’indivisibilité de la sécurité en Afrique
La CADSP reste essentielle dans la dynamique actuelle de la sécurité pour plusieurs raisons. Tout d’abord, son principe fondamental est « l’indivisibilité de la sécurité en Afrique”, qui stipule que « la sécurité d’un pays africain est indissociable de la sécurité des autres pays africains et du continent africain dans son ensemble ». Malgré la transformation significative du paysage de la paix et de la sécurité au cours des deux dernières décennies, ce principe sous-jacent est une représentation claire de la tendance actuelle en matière de sécurité sur le continent et du type de réponse politique dont le continent a besoin à ce moment précis de son histoire. Même lorsque des dynamiques et des défis internes sont à l’origine de conflits, les insécurités s’affranchissent de plus en plus des frontières et se régionalisent.
Dans le contexte actuel, la Libye – pays où cette politique historique a été adoptée et où plusieurs autres instruments multilatéraux africains ont été mis en place – est confrontée au risque de désintégration dû à des autorités rivales. L’effondrement du gouvernement libyen et l’instabilité qui s’en est suivie ont eu de larges répercussions dans le Sahel, créant un terrain fertile pour les flux d’armes illicites et les mouvements de groupes armés. Le conflit intense qui sévit actuellement au Soudan suscite des inquiétudes similaires quant à la fragmentation du pays, et ses effets se font sentir au-delà de la région de la Corne de l’Afrique. Alors que de plus en plus de pays sont déstabilisés, les ramifications régionales plus larges de ces crises pour la sécurité d’une région et du continent lui-même deviennent de plus en plus évidentes.
2 – L’absence d’une stratégie continentale cohérente
Deuxièmement, malgré la nature de plus en plus transfrontalière des défis sécuritaires, les réponses continentales manquent de cohérence stratégique. La CADSP appelle clairement à une compréhension commune de la défense et à l’adoption d’une position commune sur les questions qui peuvent être considérées comme une menace pour la sécurité collective. Des mesures parallèles et fragmentées menées par de multiples organisations sous-régionales et des engagements bilatéraux ont donné des résultats limités dans l’atténuation des menaces. La situation dans l’Est de la RDC est un exemple des effets de l’absence d’une stratégie continentale cohérente, où l’implication de multiples acteurs et mécanismes a affaibli une réponse efficace.
3- L’Afrique doit se repositionner
Troisièmement, l’évolution vers un ordre mondial multipolaire a eu un impact sur le paysage de la paix et de la sécurité du continent. Les contestations géopolitiques accrues dans lesquelles les superpuissances et les puissances moyennes défendent agressivement leurs intérêts et se taillent une sphère d’influence ont sapé la capacité des acteurs continentaux à agir de manière unifiée dans la résolution des conflits. Ce phénomène a été particulièrement prononcé dans le cas du Soudan, et plus largement dans la région de la Corne de l’Afrique, où l’implication d’acteurs extérieurs – en particulier les États du Golfe et la militarisation de la région de la mer Rouge – a compliqué les efforts en faveur de la paix et de la sécurité. À l’heure où le continent est tiré dans différentes directions par de multiples intérêts et acteurs, la CADSP rappelle à l’Afrique qu’elle doit se repositionner. Dans un contexte d’intensification des changements géopolitiques, il devient nécessaire de réaffirmer son attachement aux instruments politiques établis. Cette réaffirmation est essentielle pour protéger le continent des complexités introduites par de multiples intérêts concurrents qui posent de plus en plus de défis à la résolution et à la gestion efficaces des conflits et qui, en fin de compte, sapent les initiatives de l’Afrique elle-même.
4- La résurgence des rivalités interétatiques sur le continent
Quatrièmement, au-delà du contexte géopolitique, l’influence réduite des institutions multilatérales africaines dans de nombreux conflits et crises peut également être attribuée à leurs lacunes internes. Elles doivent donc rétablir la confiance et la crédibilité vis-à-vis des États et des citoyens africains. D’une part, nous assistons à une grave divergence entre l’UA et les les communautés économiques régionales (CER) lorsqu’il s’agit de réagir à des changements anticonstitutionnels de gouvernement, le cas le plus récent étant le coup d’État militaire au Niger, où la proposition d’intervention militaire de la CEDEAO n’a pas reçu le soutien du CPS. L’autre évolution est la tension croissante entre les CER et leurs membres. Les juntes sahéliennes ont non seulement établi leur propre alliance de sécurité, mais elles ont également annoncé leur retrait de la CEDEAO. Pour éviter une nouvelle escalade de la crise en cours et une fragmentation de la région, qui pourrait compromettre à la fois la « coopération en matière de sécurité » et l’intégration régionale, la CEDEAO a décidé de lever certaines des sanctions imposées aux pays du Sahel. Dans un autre contexte, le Soudan a suspendu son adhésion à l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), remettant en cause son rôle de médiation. Une autre tendance préoccupante est la résurgence des rivalités interétatiques sur le continent, qui affaiblissent les efforts multilatéraux en créant des divisions au sein de ces institutions et en détournant l’attention d’autres questions stratégiques. Alors que les dirigeants et les organisations sous-régionales se concentrent sur la gestion des crises dans leurs régions respectives, l’aspiration continentale à la paix et à la prospérité s’estompe.
La CADSP, un outil pour revitaliser les engagements continentaux et surmonter les divisions au niveau sous-régional
Toutefois, il est essentiel que l’UA intervienne pour éviter toute nouvelle fragmentation, et la CADSP est un outil essentiel qui peut servir de base pour revitaliser les engagements continentaux et surmonter de telles divisions au niveau sous-régional. Pour ce faire, l’UA doit faire preuve de leadership et de prévoyance pour galvaniser les États membres, qui doivent s’engager à nouveau à atteindre les objectifs qu’ils ont eux-mêmes définis dans la CADSP en matière de sécurité collective.
Conclusion : Travailler à l’avancement et à l’appropriation de la CADSP par les États membres
Étant donné qu’il existe un fossé frappant entre la vision qui a donné naissance à l’UA et ses normes, et les lacunes dans la réalisation de ces ambitions, la traduction des normes en actions nécessiterait un réengagement à tous les niveaux, national, sous-régional et continental. Lors du 37e sommet ordinaire de l’UA qui vient de s’achever, le président de la Commission a clairement appelé les États membres à renforcer leur engagement politique en faveur de la mise en œuvre des décisions de l’UA. En effet, l’UA possède plusieurs normes et politiques qui, si elles sont mises en œuvre, pourraient conduire à une transformation significative du paysage de la paix et de la sécurité sur le continent.
La CADSP est l’un de ces instruments. Le 20e anniversaire de cette politique est l’occasion de réaffirmer les principes qui constituent le fondement d’un cadre de sécurité panafricain et d’évaluer de manière critique leur importance dans le paysage sécuritaire actuel du continent. Elle offre un schéma directeur pour la sécurité collective de l’Afrique, et sa mise en œuvre peut être renforcée par des mécanismes de suivi clairs. Le CPS, en tant que principal détenteur du mandat de mise en œuvre de la politique, peut donner suite à sa décision antérieure de recevoir des mises à jour régulières de la Commission de l’UA sur l’état d’avancement de l’opérationnalisation de la CADSP. La Commission de l’UA, en tant que gardienne de cet instrument, devrait travailler à son avancement et à son appropriation accrue par les États membres, et s’assurer qu’il reste central dans le maintien de la paix et de la sécurité. Le moment est venu pour les États membres de renforcer leur engagement, non seulement à l’égard de la CADSP, mais aussi à l’égard de l’essence même de l’UA, qui reste la pierre angulaire de la recherche de la sécurité collective en Afrique.
L’auteur : Bitania Tadesse est chercheur non résident au Centre des opérations de paix de l’Institut international de la paix.
La version originale de cet article a été publié en Anglais sur International Peace Institute. Lire l’article en Anglais