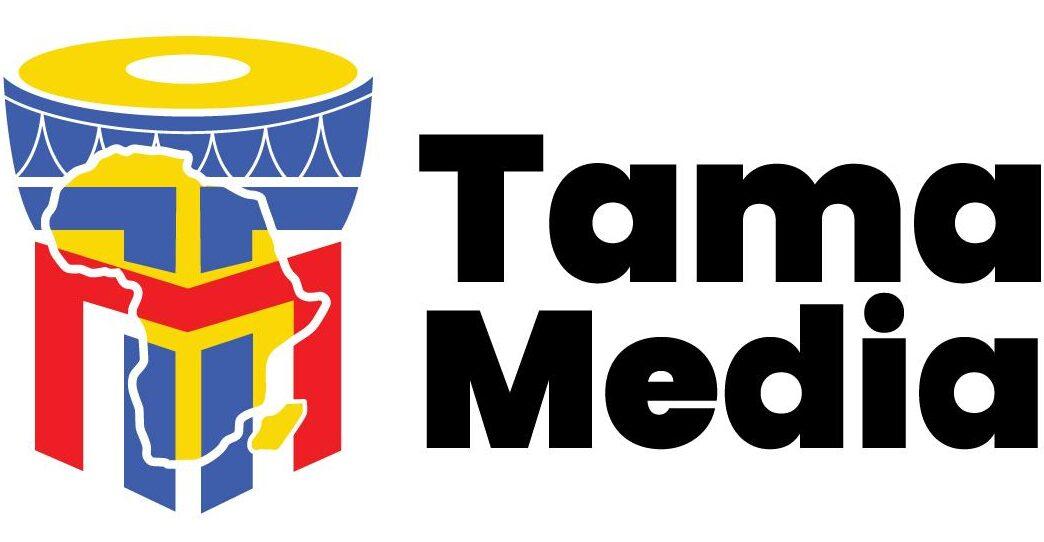Deux ans après son lancement historique, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) cristallise les espoirs de développement du continent noir. Mais ce projet d’intégration économique, inédit à une telle échelle, soulève aussi de nombreux défis. Décryptage par des experts qui se prononcent sur les progrès réalisés, les obstacles à surmonter et les opportunités à saisir.

Par Jean-Charles Kaboré
Les signaux sont encore timides, mais prometteurs. Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) avance pas à pas vers la concrétisation de son objectif ambitieux : créer un marché unique de 1,3 milliard de consommateurs à l’échelle du continent. Un défi colossal, un potentiel de développement économique et social inédit pour l’Afrique qui cherche à s’affranchir de sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères.
Sur le plan tarifaire, l’élimination des droits de douane a débuté dès janvier 2021 sur 90 % des produits échangés entre pays membres. La suppression complète des droits restants (10 %) doit intervenir d’ici décembre 2025.
En parallèle, plusieurs techniques de négociations sont toujours en cours pour parachever la mise en œuvre de la Zlecaf notamment sur les services, avec un accent sur des secteurs clés comme la finance, les transports et les télécommunications.
Un accord de protection des investissements pour promouvoir les flux d’Investissements Directs à l’Étranger (IDE) intra-africains et un autre sur la propriété intellectuelle pour protéger les innovations du continent sont également en gestation.
« Il faut reconnaître que l’implémentation de la Zlecaf est un processus qui doit s’inscrire dans la durée. Il ne faut pas s’attendre à des actions spectaculaires », tempère d’emblée M. Epiphane Adjovi, économiste et statisticien béninois.
S’il appelle à la patience, ce spécialiste salue néanmoins les premières avancées engrangées. « Il y a la ratification rapide de l’accord par 51 États sur 55 au 1er mars 2024. On peut aussi parler de l’installation du Secrétariat qui est déjà opérationnel et de l’élaboration de stratégies Zlecaf par certains pays », poursuit-il.
Au niveau des pays membres, les préparatifs réglementaires et techniques avancent aussi. Selon M. Adjovi, « 46 États membres avaient soumis leurs offres tarifaires à la fin 2022, dont 4 provenant d’unions douanières régionales existantes ». Un élément clé puisque la libre circulation des marchandises passe par la suppression progressive des droits de douane entre les pays.
« L’idée est d’avancer sur les règles d’origine cruciales pour le commerce. Un accord est presque finalisé à ce sujet dans le cadre formel des négociations qui sont en bonne voie », confirme de son côté l’économiste malien Modibo Mao Macalou, spécialiste de l’intégration régionale. Il se félicite, en outre, de « la mise en place du système panafricain de paiement et de règlement, sous l’égide de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), qui va permettre de fluidifier les transactions entre les 40 monnaies nationales du continent ».
Des promesses de création de richesses et d’emplois en masse

Au-delà des aspects techniques et juridiques, c’est surtout l’impact socio-économique espéré de la mise en œuvre effective de la Zlecaf qui enthousiasme les experts et motive les efforts consentis. « Tous les secteurs d’activités, des biens manufacturés aux services en passant par l’agroalimentaire, seront touchés. Cela va promouvoir les échanges commerciaux et la création de valeur ajoutée. Cette dernière permet d’augmenter les revenus des populations et surtout de créer des emplois dont l’Afrique a un besoin criant », souligne M. Macalou.
Selon cet expert, les études montrent que le commerce des biens et services, mais aussi le secteur manufacturier et les services numériques à haute valeur ajoutée pourraient être les grands bénéficiaires de ce marché unique africain. L’économiste malien voit dans la Zlecaf un formidable levier de croissance pour le continent.
La libre circulation des marchandises, des capitaux et la création d’emplois qu’elle va multiplier permettra une augmentation des salaires, notamment chez les travailleurs qualifiés et non qualifiés. On estime que 30 millions de personnes devraient ainsi sortir de la pauvreté grâce à la Zlecaf, détaille Modibo Mao Macalou.
Accélérer les réformes et s’appuyer sur des leviers structurants
Malgré ces promesses de prospérité économique et sociale, la mise en œuvre pleine et entière de la Zlecaf patine encore aujourd’hui. Un constat qui doit accélérer les réformes nécessaires d’après Meïssa Babou, économiste à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar : « Pour une Zlecaf qui tournerait à plein régime et profiterait à tous les pays africains, il y a quelques problèmes à régler en amont. Il faut passer au cap de l’industrialisation pour transformer sur place nos productions agricoles, minières, notre pétrole… Sinon les échanges resteront limités aux seules matières premières et tous les produits finis continueront d’être importés », affirme-t-il.
L’universitaire sénégalais pointe aussi « l’absence de corridors de transport efficaces entre les pays » comme « un frein majeur aux flux commerciaux ». Un constat que partage Epiphane Adjovi pour qui « l’unanimité semble se faire sur l’impératif d’améliorer la qualité des infrastructures routières, ferroviaires et maritimes en Afrique, mais aussi de résoudre le problème criant de déficience des réseaux de distribution et de transport du fret. »
L’autre défi soulevé par l’économiste malien est le fait qu’avec la baisse des recettes douanières, qui sont des ressources budgétaires importantes pour nombre de pays, les difficultés fiscales vont s’accroître et seront compensées. Il plaide donc pour des réformes accélérées de fiscalité intérieure pour pallier ces pertes à venir.
Enfin, à en croire Epiphane Adjovi, dans un processus d’intégration économique aussi vaste que la Zlecaf impliquant 54 nations, la question de la levée des multiples barrières non tarifaires reste un immense chantier. « Il y a l’impératif de réussir réellement et dans les meilleurs délais la difficile question de la suppression des barrières non tarifaires qui paralysent encore trop souvent les échanges », appelle-t-il de ses vœux.
Le rôle clé des acteurs publics, privés et de la société civile
Face à l’ampleur de la tâche pour concrétiser la Zlecaf, les experts s’accordent sur la nécessité d’une implication renforcée des acteurs étatiques et non étatiques, qu’ils soient issus du secteur privé ou de la société civile.
« Le succès de la Zlecaf dépendra d’abord fortement de la volonté politique réelle des États car ce sont eux qui vont prendre les décisions, planifier et mettre en œuvre les politiques publiques ambitieuses pour lever les multiples barrières juridiques, fiscales et administratives », insiste Modibo Mao Macalou.
Mais, au-delà de ces aspects, l’expert fait savoir que l’apport des acteurs non étatiques va être crucial. Les organisations du secteur privé, notamment les Petites et Moyennes Entreprises (PME), devront fournir les plus gros efforts pour améliorer les échanges, transformer et exporter les productions locales d’un pays à l’autre pour ainsi créer des emplois à haute valeur ajoutée promis par la Zlecaf, relève M. Macalou.
Quant à la société civile, elle joue un rôle crucial dans la supervision et la sensibilisation à la Zlecaf, comme le souligne Meïssa Babou : « Elle veillera également à la bonne marche sur le plan politique ».
Son pair malien abonde dans le même sens en indiquant que la société civile pourrait s’assurer que tout cela se fasse dans la transparence. C’est une chose de concevoir les accords, c’en est une autre de les mettre en œuvre. C’est à ce niveau que la société civile, mentionne Modibo Mao Macalou, pourrait être utile dans la promotion du dialogue public-privé afin d’améliorer le quotidien des populations à travers la Zlecaf.
« La défense du bien-être des consommateurs et même de l’ensemble de la population est une des obligations pour les acteurs de la société civile », rappelle Epiphane Adjovi, économiste-statisticien béninois.
En tant que voix des citoyens, la société civile surveille de près l’impact socio-économique de la Zlecaf et s’assure que les politiques commerciales bénéficient à tous. De plus, elle œuvre en faveur de politiques commerciales équitables et transparentes, garantissant la participation citoyenne dans les processus de prise de décisions.
La Zone de libre-échange continentale offre des opportunités sans précédent pour stimuler le commerce intra-africain et favoriser le développement économique du continent. Toutefois, sa réussite dépendra d’un partenariat solide entre les secteurs public et privé, et la société civile, chacun jouant son rôle dans la réalisation de cet objectif ambitieux.
S’il reste une longue route à parcourir, nul doute que ce marché continental constitue un puissant catalyseur pour hisser l’Afrique sur la scène économique mondiale. À condition de tenir la promesse d’une « belle harmonie ».