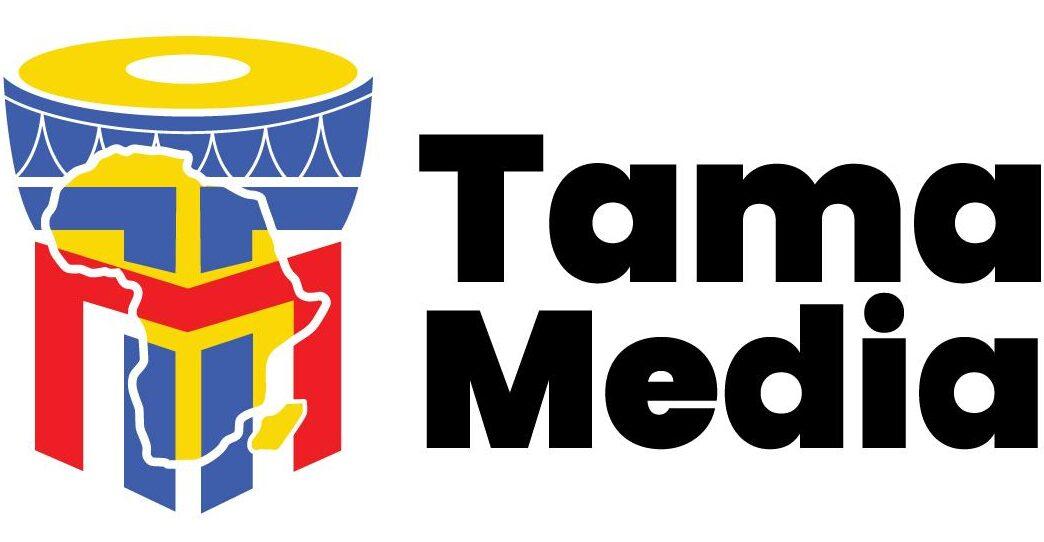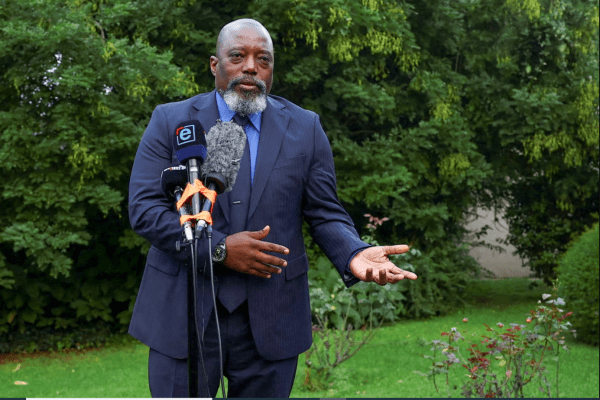Des centaines de Nord-Africains enrôlés furent envoyés pour combattre dans la guerre coloniale française en Indochine — ils y trouvèrent finalement une nouvelle vie en Asie du Sud-Est
Par Basma El Atti . Ce reportage a d’abord été publié en anglais sur New Lines Magazine. Lire la version originale
Quand son avion atterrit à l’aéroport de Salé, près de Rabat, en 1972, Zika Hajji, âgé de 16 ans, descendit pour la première fois sur la terre marocaine, dans la chaleur sèche, vers la main tendue d’un homme imposant en uniforme militaire, aux pommettes saillantes et portant de larges lunettes de soleil. Le général Mohamed Oufkir l’accueillit dans un dialecte marocain : « Kidayer, labass ? » (« Comment vas-tu ? »). Zika resta figé. Il ne parlait pas un mot d’arabe. Son père, qui n’avait pas vu sa terre natale depuis près de vingt ans, s’avança, se redressa et dit au général : « Remerciez notre roi de nous avoir ramenés. » Depuis le tarmac, Zika aperçut dans l’ombre climatisée du terminal une silhouette leur faisant signe — c’était le roi Hassan II.
Aujourd’hui âgé de 70 ans, Hajji se souvient de ce moment avec un sourire : son premier pas sur ce qui était alors une terre étrangère, et qui allait devenir son foyer.
« C’est une histoire d’amour et de résistance », dit-il en arabe, mais avec un accent marqué par sa vie d’avant — celle que son père avait bâtie dans un petit village près de Hanoï, au Vietnam, avec d’autres déserteurs marocains de l’armée française qui avaient combattu aux côtés des Vietnamiens pendant la guerre d’Indochine.
La campagne du Viet Minh et l’appel à la désertion
À la recherche de déserteurs potentiels, le Viet Minh lança des campagnes de propagande intensives, diffusant des messages en français via Radio Hanoï. Les Nord-Africains étaient appelés à ne pas se battre pour un empire oppresseur. Des tracts furent également largués depuis des avions : l’un d’eux montrait un soldat marocain embrassant un soldat vietminh, tandis qu’un autre disait :
« Le Viet Minh vous garantit sécurité, liberté et fraternité si vous vous rendez. »
Pour convaincre davantage, ils évoquaient des figures emblématiques de la résistance anticoloniale, comme Abd el-Krim al-Khattabi, le chef berbère qui avait combattu les Espagnols et les Français dans le Rif marocain dans les années 1920.
Quand le roi Mohammed V du Maroc fut exilé à Madagascar par la France en 1953, la colère monta parmi les soldats marocains. Beaucoup, déjà mécontents, virent dans cet acte un affront personnel et une trahison. C’est dans ce climat que de nombreux Nord-Africains désertèrent, rejoignant les rangs du Viet Minh.
Vivre et combattre aux côtés du Viet Minh
Les déserteurs marocains furent initialement regroupés dans des bataillons distincts, où ils furent intégrés dans l’effort militaire du Viet Minh. Certains combattirent directement contre leurs anciens camarades français ; d’autres apportèrent un soutien logistique, formant les Vietnamiens aux tactiques européennes ou servant de traducteurs.
La victoire du Viet Minh à Diên Biên Phu en 1954, événement décisif qui mit fin à la guerre d’Indochine, fut également celle de ces déserteurs. Mais leur choix eut un prix élevé : ils ne pourraient jamais retourner au Maroc tant que le pays resterait sous influence française.
La fondation d’un village marocain au Vietnam
Confrontés à l’impossibilité de rentrer chez eux, les anciens soldats marocains s’établirent durablement au Vietnam. L’État vietnamien leur attribua des terres dans la région de Ba Vi, au nord-ouest de Hanoï, où ils fondèrent une petite communauté.
Ils construisirent une porte monumentale, surmontée d’arcs mauresques et de motifs islamiques, surnommée par les Vietnamiens “la Porte du Maroc”. Ils épousèrent des femmes vietnamiennes, créèrent des familles, et adaptèrent peu à peu leur culture et traditions à leur nouvel environnement.
La guerre du Vietnam : une nouvelle épreuve
La paix fut de courte durée. Dans les années 1960, la guerre éclata de nouveau, cette fois contre les États-Unis et le Sud-Vietnam soutenu par l’Occident.
Les familles maroco-vietnamiennes furent prises dans la tourmente. Elles subirent les bombardements, les famines, les déplacements forcés. Malgré tout, elles restèrent attachées à la cause du Nord-Vietnam.
Le retour au Maroc : une promesse royalement tenue
En 1972, le roi Hassan II du Maroc ouvrit les portes aux vétérans marocains et à leurs familles. Il leur offrit la possibilité de revenir au pays, promettant terre, logement et intégration.
Environ 80 familles saisirent cette opportunité. Elles s’établirent principalement près de Sidi Yahya El Gharb, dans une région surnommée “le village chinois”.
Héritage d’une double identité
Aujourd’hui, la communauté vietnamo-marocaine tente de préserver son héritage singulier. Les descendants célèbrent à la fois les fêtes musulmanes comme l’Aïd et les traditions vietnamiennes comme le Têt.
Certaines femmes âgées continuent de porter des tenues vietnamiennes ornées de bijoux marocains, symbole d’une identité multiple.
« On ne peut pas forcer un sentiment d’appartenance », dit Hajji. « Mais ils savent que leurs grands-parents étaient des héros. »