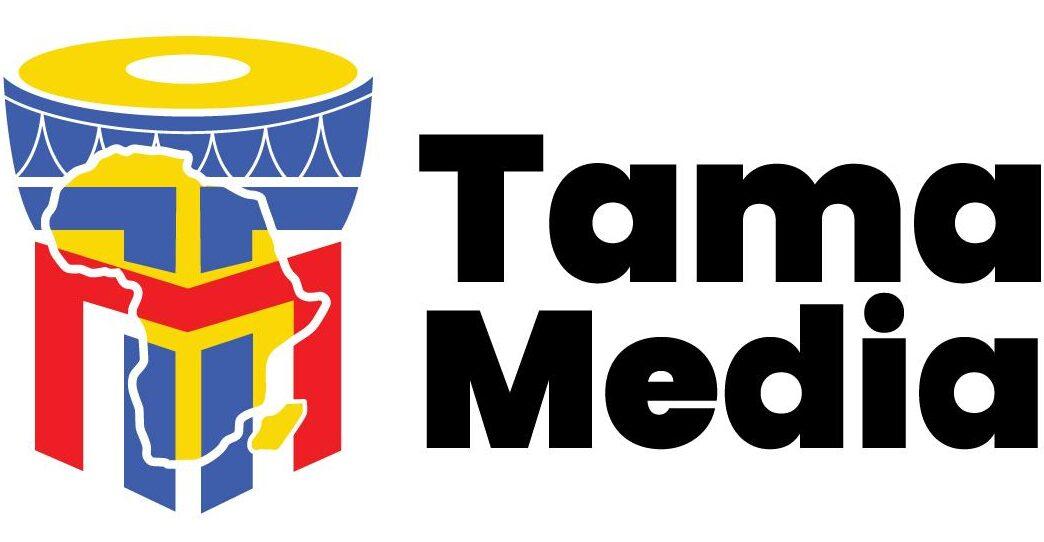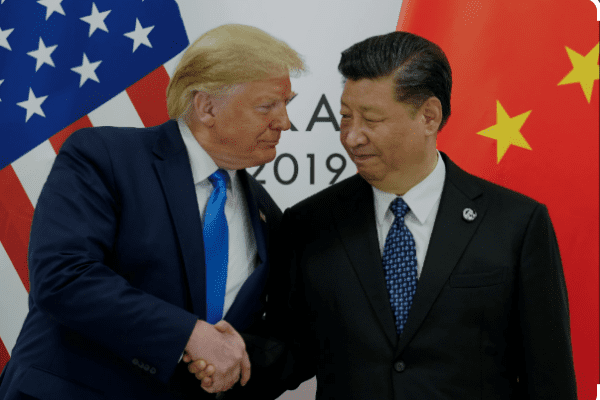Les Forces armées maliennes ont repris Kidal le 14 novembre 2023. Soit deux semaines après que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a quitté cette ville septentrionale considérée comme le bastion des ex-rebelles séparatistes réunis aujourd’hui au sein du Cadre Stratégique Permanent pour la Paix, la Sécurité et le Développement (CSP-PSD).

Le départ précipité de la mission onusienne de l’Adrar des Ifoghas, justifié notamment par le contexte sécuritaire, et la fermeture de son camp à Ansongo, toujours dans le Nord du pays, portent à neuf le nombre de bases fermées au Mali sur un total de treize dans le cadre du retrait des troupes devant s’achever, au plus tard, le 31 décembre prochain.
À la date du 17 novembre, la Minusma a affirmé dans un post X (ex-Twitter) avoir retiré du Mali « 8364 membres du personnel » civil et en uniforme sur un total de 13.871, en vertu de la Résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au terme de ce processus, la junte entend « rétablir l’ordre, la sécurité et la stabilité dans toutes les ex-zones d’implantation de la Minusma et sur l’ensemble du territoire national ».
Spécialiste des questions de gouvernance, de paix et de sécurité en Afrique, Mahamadou N’fa Simpara, auteur par ailleurs du livre « De l’OUA au G5 Sahel : une brève histoire de la gouvernance sécuritaire en Afrique », livre à Tama Média une analyse sans fard de la dynamique enclenchée.

Le 14 novembre 2023, l’armée malienne a pris position à Kidal, une localité tenue jusqu’alors par les ex-rebelles. Ceux-ci, dans un communiqué publié le même jour, ont annoncé « se retirer de la ville pour des raisons stratégiques dans cette phase de combats ». Quelle est votre lecture de ces évènements ?
La reprise de Kidal par l’armée malienne constitue indéniablement une étape cruciale dans la quête de notre souveraineté nationale, remise en cause depuis plus d’une décennie. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, de rendre hommage à ces valeureux soldats tombés pour la défense et le recouvrement de notre intégrité territoriale.
Cela dit, la grandeur de cette victoire réside non seulement dans la bravoure des Forces armées maliennes, mais aussi dans la vision stratégique nécessaire pour aller au-delà du simple contrôle militaire. Nous sommes actuellement à la croisée des chemins, et le succès de cette opération dépendra de notre capacité à entreprendre un processus de reconstruction administrative et sociale profond.
En effet, le contrôle administratif va au-delà du contrôle militaire et nécessite une approche holistique. Comment allons-nous rétablir les services publics, réintégrer les communautés locales, y compris les ex-rebelles, et construire un avenir inclusif pour tous les habitants de la région ? Ces questions exigent une réflexion profonde et des actions déterminées.
Ainsi, bien que la victoire soit célébrée, mon esprit est tourné vers l’avenir. Comment transformer cette réussite militaire en un succès administratif et social durable ? Comment construire une paix ancrée dans la compréhension mutuelle et la coopération continue ?
Ce ne sont là que quelques-uns des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que nation, car la paix n’est pas seulement une réalité momentanée, mais une force durable qui doit guider notre nation vers un avenir prospère.
Dans le cadre de la deuxième phase de son retrait, débuté en septembre, la Minusma a fermé plusieurs emprises (Douentza, Aguelhok, Tessalit…) dont certaines sur fond de tensions. La dernière en date est celle de Kidal quittée le 31 octobre 2023. Selon un communiqué de la mission onusienne, « près de 400 Casques bleus, qui auraient dû être ramenés à Gao par avion, ont été obligés de prendre la route ». Que vous suggère tout cela ?
Le contexte du retrait de la Minusma soulève des questions cruciales quant à l’efficacité des opérations de consolidation de la paix des Nations Unies, particulièrement dans des environnements complexes tels que celui du Mali.
Le cas malien met en lumière une lacune structurelle majeure au sein des Nations Unies, à savoir son incapacité à se réinventer et à adapter rapidement ses mandats aux réalités changeantes sur le terrain. Les autorités maliennes avaient précédemment exprimé le besoin crucial d’ajuster le mandat de la Minusma pour le rendre plus adaptable au contexte sécuritaire évolutif du pays. Cette demande a, malheureusement, été reléguée au second plan au profit d’un retrait qui semble maintenant entaché par des défis opérationnels notables.
Cependant, cette critique ne doit pas nécessairement conduire à la conclusion que la Minusma était inutile ou superflue. Tel n’est pas mon propos. Au contraire, le mandat initial de la mission comprenait également la responsabilité d’appuyer, avec tous les moyens nécessaires, la mise en œuvre de l’Accord d’Alger pour la paix et la réconciliation au Mali par les parties signataires et prenantes maliennes. Cet accord, axé sur la résolution des tensions politiques et sécuritaires, démontre la nécessité d’une présence internationale pour appuyer les efforts nationaux dans des contextes aussi complexes.
En outre, j’estime que les Nations Unies doivent maintenant effectuer une sérieuse introspection et faire montre d’une volonté de réforme. Il est impératif que l’organisation repense ses stratégies, améliore la coordination avec les acteurs locaux et développe des mécanismes plus agiles pour s’adapter aux réalités mouvantes sur le terrain.
L’échec à s’adapter compromet non seulement l’efficacité des missions futures, mais risque également de porter atteinte à la crédibilité des Nations Unies en tant qu’acteur majeur dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales. Apprendre de ces expériences passées et mettre en œuvre des réformes substantielles sont des impératifs pour garantir que les missions de paix de l’organisation puissent répondre de manière proactive et efficace aux défis complexes des conflits contemporains.
La Minusma se dit déterminée à respecter la date butoir malgré le contexte sécuritaire. Le gouvernement malien, de son côté, a réaffirmé son attachement au respect de ce délai. Mais dans les faits, il continue d’imposer aux Casques bleus des restrictions de déplacement. Il y a quelques semaines, la mission onusienne a dénoncé « le blocage à Gao, depuis fin septembre, des convois logistiques qui devaient rallier la région de Kidal et rapatrier les équipements lourds appartenant aux pays contributeurs de troupes et de personnels de police ainsi qu’aux Nations Unies ». Comment expliquez-vous cette situation ?
Dans la Résolution 2690 (2023), adoptée le 30 juin 2023 par le Conseil de sécurité, les termes sont clairs. Cependant, la mise en œuvre du retrait de la mission pose des difficultés d’interprétation, de compréhension et logistiques.
Il est crucial de reconnaître que le respect du calendrier fixé dans la Résolution dépend de la collaboration étroite entre la Minusma et le gouvernement malien. Les restrictions de déplacement imposées compliquent la réalisation de cette mission.
Le blocage des convois logistiques à Gao, notamment depuis fin septembre, est une manifestation tangible de ces difficultés. Cela affecte non seulement la logistique opérationnelle de la Minusma, mais compromet également le rapatriement des équipements lourds appartenant aux pays contributeurs. Ces retards peuvent potentiellement remettre en question la capacité de la mission à respecter le calendrier prévu.
Dans ce contexte, il est impératif que les parties prenantes, y compris le gouvernement malien, la Minusma et les contributeurs internationaux, travaillent de manière collaborative pour résoudre ces problèmes logistiques et faciliter une transition ordonnée. Le dialogue et la coopération restent essentiels pour surmonter les obstacles pratiques et assurer le succès de cette entreprise délicate.
Depuis la reprise des hostilités dans le Nord du Mali, l’Algérie, l’un des garants de l’Accord de paix de 2015, brille par son silence. Que peut-on en déduire ?
Le mutisme apparent de l’Algérie, en dépit de son rôle clé en tant que garant de l’Accord de paix de 2015, peut être appréhendé à travers une analyse minutieuse des dynamiques régionales et des évolutions internes. Plusieurs éléments contribuent à cette réserve apparente de la part du voisin algérien, connu traditionnellement pour son dynamisme dans les processus de paix et de sécurité dans la région. Le principal est l’approche préconisée par Bamako depuis maintenant un certain temps.
En effet, la posture adoptée par le gouvernement de transition à Bamako joue un rôle crucial dans la perception du silence algérien. L’engagement délibéré de ne pas conditionner le succès des opérations et des processus à la présence active d’un partenaire étranger a notablement restreint la marge de manœuvre d’Alger. Depuis l’avènement de cette nouvelle administration, on observe une tendance marquée vers une approche de « nationalisation » des questions sécuritaires. Cela se traduit par une volonté manifeste de se libérer des missions onusiennes et de tout autre partenariat international, qu’il soit multilatéral ou bilatéral.
En se débarrassant de la tutelle internationale, le gouvernement malien semble vouloir exercer un contrôle plus direct sur les décisions stratégiques liées à la sécurité, alignant ainsi ses actions sur ses propres intérêts et priorités nationales.
Après le retour à Kidal, quelles sont les pistes pour aller vers une paix durable ?
La paix, selon moi, n’est ni une fatalité ni une certitude manquante. Il est essentiel de reconnaître que la récente victoire militaire à Kidal, bien que significative, ne représente qu’une étape préliminaire dans la quête d’une stabilité durable. Pour consolider cette avancée, plusieurs aspects cruciaux doivent être méticuleusement abordés.
Tout d’abord, la victoire sur le plan militaire doit être étayée par des stratégies intégrées visant à établir une présence administrative robuste dans la région. Une administration effective, transparente et réceptive aux besoins locaux est fondamentale pour restaurer la confiance des citoyens envers l’État. Cela nécessite la mise en place rapide d’institutions administratives fonctionnelles, capables de fournir des services publics de manière efficiente.
Parallèlement, des mesures substantielles en matière de développement socio-économique sont indispensables. Les programmes ciblés doivent être déployés pour atténuer les causes profondes des tensions, en se concentrant sur l’amélioration des conditions de vie, l’accès à l’éducation et la création d’opportunités économiques. Un investissement judicieux dans des projets de développement durable contribuera à transformer le paysage économique de Kidal, réduisant ainsi les incitations à l’instabilité.
De plus, il est impératif de promouvoir une gouvernance participative en intégrant activement les voix locales dans le processus décisionnel. Les communautés locales, souvent marginalisées, doivent être parties prenantes des discussions et des décisions qui affectent leur quotidien. Cela favorisera non seulement une représentation adéquate, mais renforcera également le sentiment d’appartenance à un État inclusif.
Enfin, un dialogue inclusif et constructif avec toutes les parties prenantes est incontournable. Les négociations ne doivent pas s’arrêter. Elles doivent être basées sur le respect mutuel, tout en reconnaissant les préoccupations légitimes de toutes les parties. Une approche diplomatique nuancée est nécessaire pour créer des accords de paix durables qui favorisent la coexistence pacifique.