Le 29 juillet 2025, après des mois de suspense soigneusement entretenu, Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à un quatrième mandat présidentiel. À 83 ans, le chef de l’État ivoirien justifiait ce choix par les défis économiques et sécuritaires que traverse le pays. De technocrate du FMI à chef d’État controversé, Alassane Ouattara a façonné la vie politique ivoirienne depuis plus de trois décennies.
Le lundi 27 octobre 2025, il a été proclamé vainqueur de l’élection présidentielle avec près de 90 % des voix, selon les résultats officiels provisoires, confirmant ainsi son emprise durable sur la scène politique ivoirienne. Retour sur les tournants d’un parcours semé de ruptures, de crises et de stratégies.
Le technocrate qui dérange (1990)
Rien ne prédestinait Alassane Dramane Ouattara à devenir le pivot de la scène politique ivoirienne. En 1990, cet économiste reconnu, alors directeur adjoint du FMI, est appelé au chevet d’une économie nationale en crise par le président Félix Houphouët-Boigny. Devenu Premier ministre, il incarne la rigueur économique… mais aussi une certaine étrangeté au sérail politique ivoirien.
Son efficacité économique séduit. Mais dans l’ombre, elle inquiète. Certains héritiers du Vieux craignent déjà un homme aux réseaux puissants et à l’ascension trop rapide.
L’“Ivoirité”, une arme d’exclusion (1995–2000)
À la mort d’Houphouët en 1993, la lutte de succession fait rage. En 1995, Ouattara est accusé de ne pas être “Ivoirien d’origine”, une controverse qui accouche d’un concept aussi flou que ravageur : l’“ivoirité”.
Sous ce prétexte, il est exclu de la présidentielle. L’homme du FMI devient alors l’opposant empêché, celui que le système refuse d’affronter dans les urnes. Il fonde le Rassemblement des Républicains (RDR) et se pose en victime d’un système ethno-politique verrouillé.
Exil forcé, retour stratégique (2000–2005)
Refoulé une nouvelle fois lors de la présidentielle de 2000, Ouattara quitte le pays. Pendant la crise de 2002, il est accusé d’avoir des accointances avec la rébellion armée, sans jamais être formellement impliqué. Ce flou nourrit autant les soupçons que sa légende.
En 2005, les Accords de Pretoria confirment son droit à concourir. Ouattara revient, prêt à en découdre. L’opposant exclu est désormais un homme attendu.
2010 : une victoire à double tranchant
Élu en 2010 face à Laurent Gbagbo, sa victoire déclenche une crise post-électorale sanglante. Gbagbo refuse de céder le pouvoir. Les affrontements font plus de 3 000 morts. Avec le soutien de la France et de l’ONU, Ouattara accède enfin à la magistrature suprême.
Mais ce premier mandat débute dans la douleur : il hérite d’un pays fracturé. Il impose une politique de reconstruction économique rapide, mais sous haute tension politique.
L’homme des grands travaux, mais pas du pardon (2011–2015)
Ouattara relance l’économie, multiplie les projets d’infrastructure, attire les investisseurs. La Côte d’Ivoire retrouve de la croissance. Pourtant, la justice transitionnelle est à sens unique : seuls les proches de Gbagbo sont poursuivis, les siens épargnés. Le discours de réconciliation ne suffit pas à panser les plaies.
La rupture du troisième mandat (2020)
Réélu en 2015, il promet de ne pas se représenter. Mais la mort de son dauphin, Amadou Gon Coulibaly, change la donne. Il revient sur sa parole et brigue un troisième mandat, déclenchant colère, boycott et violences.
Son élection est entachée d’un contexte autoritaire, avec l’éviction judiciaire de plusieurs candidats de poids. Malgré les critiques, Ouattara est réélu pour un mandat qu’il estime conforme à la Constitution.
Une transition verrouillée ? (2025)
Le 29 juillet 2025, après des mois de flou soigneusement entretenu, Alassane Ouattara annonce sa candidature à un quatrième mandat présidentiel dans une allocution vidéo diffusée sur la télévision nationale et les réseaux sociaux. À 83 ans, il justifie sa décision par les défis économiques, sécuritaires et climatiques qui, selon lui, exigent « expérience et continuité ». Il affirme : « La Constitution me le permet, ma santé me le permet. J’ai décidé d’être candidat. »
Cette annonce provoque une levée de boucliers dans l’opposition, qui dénonce une dérive autoritaire et un mépris du principe d’alternance. Pour de nombreux acteurs politiques, cette candidature intervient dans un paysage politique déjà verrouillé, où les principales figures capables de faire contrepoids ont été écartées.
Parmi elles, Tidjane Thiam, figure du PDCI et ancien patron du Crédit Suisse, a été radié des listes électorales par la justice ivoirienne au motif qu’il avait perdu la nationalité ivoirienne en acquérant la nationalité française dans les années 1980. Son recours a été rejeté, le rendant inéligible pour la présidentielle d’octobre.
Laurent Gbagbo, bien qu’investi par son parti, le PPA-CI, est toujours frappé d’inéligibilité, en raison d’une condamnation pour le pillage de la BCEAO en 2011, condamnation qu’il conteste mais qui n’a pas été effacée. Guillaume Soro, en exil depuis 2019, reste lui aussi condamné à 20 ans de prison et ne peut se présenter.
Pour l’opposition et plusieurs organisations de la société civile, le recours à l’outil judiciaire pour écarter des adversaires politiques mine le processus démocratique. À leurs yeux, cette présidentielle s’annonce jouée d’avance, dans un contexte de concentration extrême du pouvoir exécutif.
Une figure double
Alassane Ouattara reste une figure ambivalente. Pour certains, il est l’artisan de la modernisation économique, pour d'autres, un homme de pouvoir prêt à tordre la loi pour s’y maintenir. Victime du droit hier, il en est devenu le principal architecte aujourd’hui, selon ses détracteurs.
Son parcours, entre exclusion et domination, dit tout des tensions qui traversent la démocratie ivoirienne.






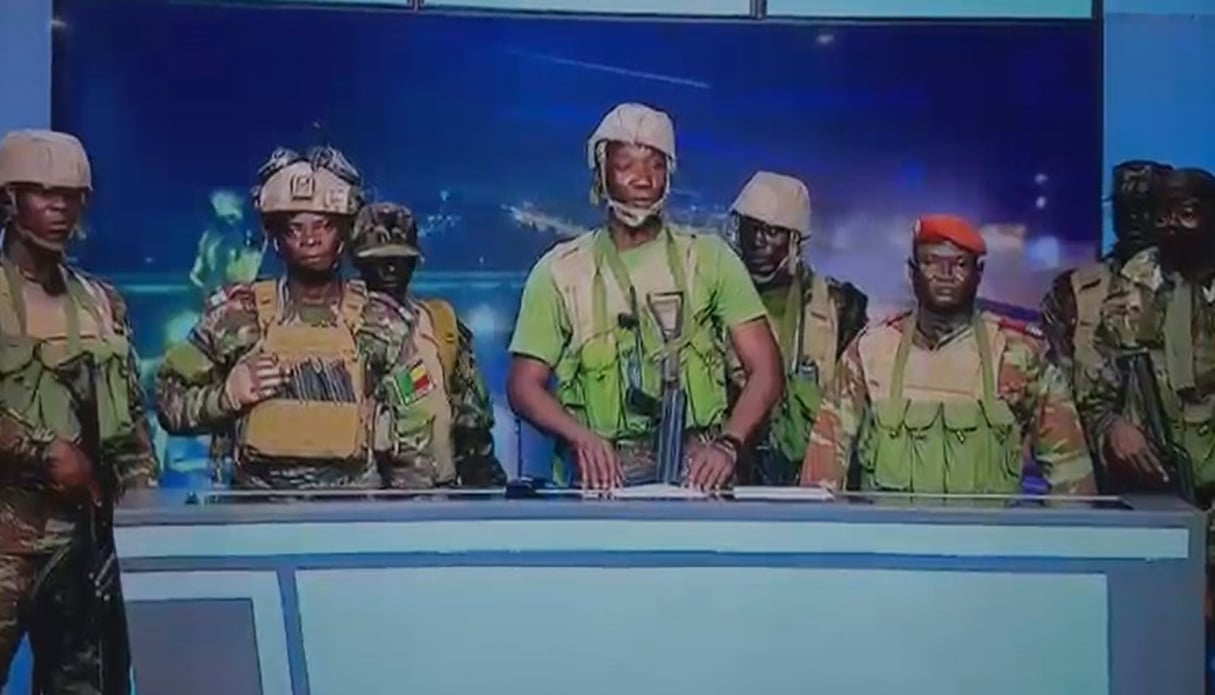
Commentaires (0)
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.
Soyez le premier à commenter !