Quand les armes se sont tues à El Fasher, fin octobre 2025, le son qui a suivi n’était pas celui de la victoire, mais le silence creux de l’épuisement. Après dix-huit mois de siège, la capitale du Nord-Darfour — dernière grande ville encore sous contrôle de l’armée — s’est enfin effondrée.
Par Suraj Yadav, analyste en risques géopolitiques. Titulaire d’un master en diplomatie, droit et affaires internationales de l’Université O.P. Jindal Global (Inde). Cet article a d'abord été publié en angalis sur Geopolitical Monitor. Lire l'original
Les rues autrefois résonantes des pas de familles déplacées murmuraient désormais avec la cendre. Les hôpitaux étaient devenus des morgues, et l’horizon respirait la fumée.
Pourtant, sous les ruines, autre chose avait pris forme : le squelette d’un nouvel ordre s’étendant des vallées brûlées du Darfour jusqu’aux silhouettes miroitantes du Golfe. La chute d’El Fasher était bien plus qu’une bataille perdue. Elle a marqué le moment où une guerre a commencé à redessiner la carte du Soudan, et, à bien des égards, son sens même. Les Forces de soutien rapide (RSF), nées des cendres des Janjawid, ont évolué de milices locales en une entreprise transnationale. Ce qui avait débuté en 2023 comme une querelle entre deux généraux — Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti, et Abdel Fattah al-Burhan — est devenu un démantèlement méthodique d’un État bâti sur le clientélisme, la violence et l’or.
La guerre qui a dévoré ses créateurs
L’histoire des RSF a commencé, significativement, comme un acte de contrôle. En 2013, le président Omar el-Béchir forma une force pour pacifier le Darfour, recrutant des hommes issus de milices tribales déjà tristement célèbres pour leurs atrocités. Il les paya, leur refusa tout vrai pouvoir, et supposa que la loyauté suivrait. Elle ne suivit pas. Ce qu’il créa à la place fut une armée privée avec ses propres appétits.
Puis vint l’or
Lorsque les veines de Jebel Amer commencèrent à luire, le destin de la région bascula. Hemedti, ancien marchand de chameaux doté d’un instinct aiguisé pour les marchés et les humeurs, s’empara des mines. Par chance ou calcul, ce geste le fit passer du statut de chef de guerre provincial à celui d’acteur national. Dès 2018, des entreprises liées aux RSF dominaient le commerce informel de l’or soudanais, et les chercheurs estimaient que plus des deux tiers de la production échappaient à la Banque centrale.
L’or était acheminé en contrebande par des réseaux complexes qui se terminaient dans les raffineries de Dubaï.
Le métal quittait le Darfour dans des sacs, et arrivait dans le Golfe poli, emballé et lavé de son passé.Ce qui suivit fut un marché tacite. Les seigneurs de guerre soudanais fournissaient des lingots, les courtiers du Golfe offraient des dollars, du carburant et un accès discret. Chacun obtenait ce qu’il voulait, et peu posaient de questions. Les RSF devinrent riches, autonomes et presque intouchables. Lorsque Béchir tomba finalement en 2019, l’équilibre du pouvoir avait déjà basculé.
Au sein du conseil de transition, Hemedti ne siégeait pas en subalterne. Il siégeait en actionnaire. Il parlait de réforme tandis que ses hommes patrouillaient encore des rues imprégnées de sang. Sa richesse lui donnait de l’influence, les mines lui assuraient l’indépendance, et ses réseaux de clientélisme le rendaient durable. Pour beaucoup de Soudanais, il apparaissait à la fois comme partenaire et prédateur.
Début 2023, les discussions dites “d’intégration”, censées fusionner les RSF dans l’armée régulière, ressemblaient moins à des négociations qu’à un compte à rebours. Pour Hemedti, l’intégration signifiait la reddition.
Pour Burhan, c’était la dernière chance de sauver un commandement unifié. La guerre qui suivit ne naquit pas d’un malentendu, mais l’arithmétique de l’ambition.
Une seule armée pouvait subsister, et chacun voulait que ce soit la sienne.
Une guerre financée par l’or
Dès les premiers jours des combats, il fut évident que les RSF ne venaient pas les mains vides. Leurs convois se déplaçaient avec des véhicules modernes, des radios cryptées et des lignes d’approvisionnement défiant la géographie. Tandis que l’armée à Port-Soudan comptait ses réserves à la baisse, les forces d’Hemedti puisaient dans un autre trésor. Leur guerre tournait à l’or.
Le contrôle des mines du Darfour et du Kordofan, et la taxation discrète du commerce sahélien, assuraient aux RSF un flux de devises fortes que l’État ne pouvait égaler.
À l’intérieur du pays, des officiers faisaient double emploi en tant qu’entrepreneurs, gérant les zones minières, percevant des taxes, dirigeant des flottes. Les cargaisons de lingots glissaient vers l’ouest à travers le Tchad et la Centrafrique, ou vers le sud jusqu’au Soudan du Sud, avant de réapparaître dans les raffineries du Golfe. Une fois arrivé à Dubaï, le métal avait perdu toute trace de son origine.
Les responsables des Émirats arabes unis affirment que leur commerce de l’or est transparent. Peut-être. Mais la provenance des cargaisons issues de zones de conflit est souvent poliment ignorée. Des avions transportant de l’aide vers Port-Soudan ont été vus quittant des pistes isolées avec des cargaisons non déclarées. Pour Abou Dhabi, le calcul semble pragmatique : accès à de l’or bon marché, parts futures dans le foncier et la logistique, et un point d’ancrage sur la mer Rouge.
Pour les RSF, ces mêmes routes signifient liquidités et une forme de légitimité — pas un État, mais assez proche pour en imiter les attributs.Ce qui a émergé, c’est une souveraineté sans institutions. Les RSF gouvernent des territoires, taxent le commerce et financent leur armée par le commerce international.
Les combattants sont payés en dollars, les officiers voyagent librement, et leur chef se présente comme un “général-entrepreneur” promettant l’ordre là où l’État a échoué.
Sous cette façade brille une fragilité : une économie de seigneur de guerre où les armes gardent les mines, et où les mines paient pour davantage d’armes.
Un empire de poussière et de lingots, achetant le lendemain avec les gains du jour.
El Fasher : le siège qui a redessiné la carte
Pendant dix-huit mois, El Fasher a retenu son souffle.
Une ville qui abritait jadis les familles déplacées par d’anciennes guerres était devenue le dernier bastion vacillant de résistance au Darfour. À l’été 2024, ses défenseurs — soldats, volontaires et milices locales — ne survivaient plus que par ténacité et souvenirs.
La farine avait disparu, l’électricité manquait, et les chirurgiens opéraient à la lueur des bougies.
Un médecin confia à un journaliste en visite : « Nous mesurons le temps au bourdonnement au-dessus de nos têtes », parlant des drones. Quand El Fasher tomba enfin, en octobre 2025, l’effondrement fut à la fois physique et symbolique. Les cinq capitales du Darfour passèrent sous contrôle des RSF, et l’armée se replia vers l’est, en direction de Port-Soudan. Le Soudan occidental cessa de ressembler à une province et commença à se comporter comme un pays parallèle.
La dévastation était stupéfiante. Les images satellites montraient des quartiers entiers rasés, en particulier ceux habités par les Masalit, rappelant les horreurs antérieures du Darfour. Pourtant, la capture d’El Fasher n’était pas seulement militaire, elle était marchande.
La ville se situe au croisement des routes reliant les champs aurifères de Jebel Amer aux voies menant vers le Tchad et la Centrafrique. Quand les convois des RSF ont franchi les portes, ils n’ont pas seulement pris un territoire, ils ont saisi des artères. Carburant, nourriture et lingots commencèrent à circuler sous leur escorte. La logistique devint levier, et le levier devint pouvoir.
C’est pourquoi cette chute compte tant. Elle a marqué le moment où les RSF ont cessé d’agir comme une insurrection pour fonctionner comme un gouvernement. Territoire, revenus, reconnaissance — la sinistre trinité de la légitimité moderne — se sont déplacés vers l’ouest.
La fin du siège n’annonce pas la paix ; elle annonce la permanence. L’Ouest du Soudan ressemble désormais à un micro-État dirigé par une milice, financé par l’or, gardé par les armes et discrètement soutenu par ceux qui continuent à commercer avec lui.
Empire de poussière : l’avenir de la guerre au Soudan
Le Soudan ressemble aujourd’hui à deux pays qui se superposent dans un même corps épuisé. À l’ouest, les RSF règnent par l’or et l’argent du Golfe. À l’est, l’armée s’accroche aux droits de douane, à l’aide étrangère et à la rhétorique patriotique. Les deux survivent en taxant le commerce, en courtisant des parrains et en reportant le coût sur les civils.
Ce qui les unit, tragiquement, c’est la faim.
Ce n’est plus un affrontement idéologique, mais une lutte pour la souveraineté économique. Les convois d’or serpentent hors du Darfour pour financer les armes qui protègent les mines. Les blocus portuaires font grimper les prix, rendant la contrebande plus rentable que la paix.
La guerre civile soudanaise se nourrit d’elle-même, un serpent qui se mord la queue, digérant le chaos pour calories.
Hemedti se présente désormais comme un modernisateur, promettant investissements et emplois pendant que ses hommes surveillent encore des villages noircis par les flammes. Burhan s’enveloppe dans le drapeau, jurant de défendre l’unité même si ses officiers profitent des mêmes réseaux de contrebande. Deux uniformes, même logique.
Les voisins se sont adaptés. Les Émirats entretiennent des liens discrets avec le commerce ; l’Égypte prête à l’armée une assistance silencieuse pour protéger les intérêts liés au Nil ; et des contractants russes gardent des sites miniers en échange de concessions. L’idéologie paraît secondaire face aux opportunités. Comme l’a résumé un diplomate à Nairobi : « La stabilité est noble, mais l’instabilité rapporte parfois. »
Pendant ce temps, la crise humanitaire s’aggrave. Plus de dix millions de Soudanais ont été déplacés, les camps au Tchad et au Soudan du Sud débordent. Les convois d’aide sont taxés ou bloqués par ceux-là mêmes qu’ils cherchent à contourner. Chaque sac de farine devient une monnaie d’échange, chaque vaccin un péage. Parfois, on a l’impression que la guerre a monétisé la compassion elle-même. Au-delà du Soudan, le monde observe avec une politesse paralysée.
Les gouvernements occidentaux publient des déclarations de préoccupation, sanctionnent quelques figures des RSF, puis évitent les routes de l’or qui comptent le plus. L’or du conflit continue de briller sur les marchés de Dubaï, et les débats à Genève tournent en rond : veto de Moscou, abstention de Pékin, exhortations de Washington. Dans les couloirs des Nations unies, un envoyé a été entendu qualifiant le Soudan de « tragique, complexe, dispensable ». Des mots cruels, mais certains jours, tristement plausibles.
Voici l’ironie amère : le même or qui finance les atrocités orne les poignets et les alliances de Londres à Los Angeles. La distance entre les cendres d’El Fasher et le comptoir d’une boutique n’a jamais semblé aussi courte.
Alors non, la prise d’El Fasher par les FSR ne met pas fin à la guerre. Elle la durcit. Le système fonctionne trop bien pour ceux qui en profitent. Tant que l’or gardera son éclat, les armes ne se tairont pas. L’empire de poussière perdure, grain après grain, pendant que le monde continue de détourner le regard de la fumée.
Par Suraj Yadav est analyste en risques géopolitiques, spécialisé en sécurité internationale, diplomatie, prospective stratégique et politique de défense. Titulaire d’un master en diplomatie, droit et affaires internationales de l’Université O.P. Jindal Global, il a collaboré avec des institutions telles que le Centre for Land Warfare Studies (CLAWS) et le United Service Institution of India (USI).
Ses analyses ont été publiées dans E-International Relations, Modern Diplomacy, Defence Research and Studies (DRaS) et le Defence Horizon Journal.
Ses travaux portent sur la géopolitique, la diplomatie et le droit humanitaire, en examinant la manière dont les recompositions du pouvoir mondial et les rivalités régionales influencent les conflits, les stratégies et l’ordre international.




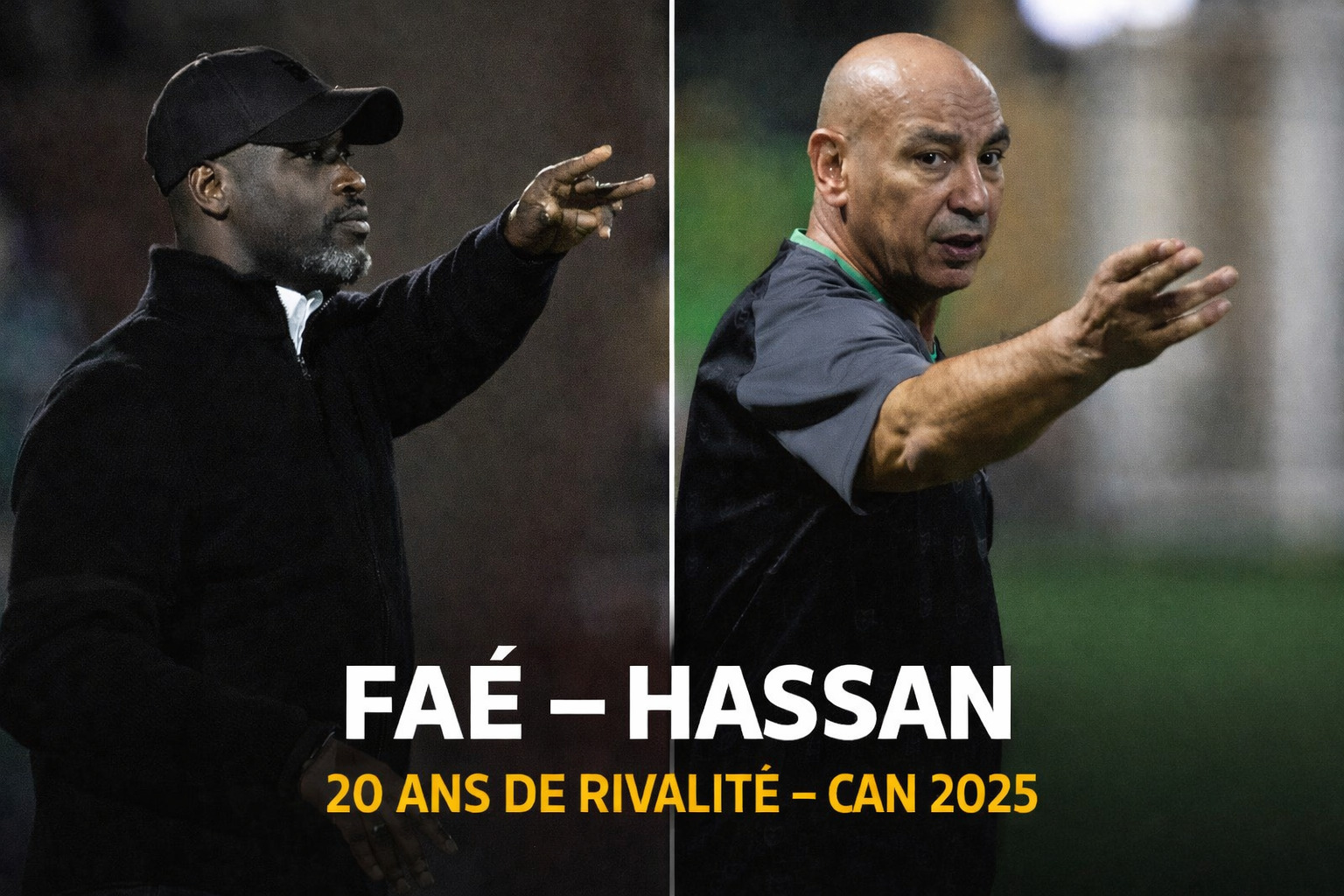


Commentaires (0)
Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.
Soyez le premier à commenter !