Le 29 mai 2024, les Sud-Africains se sont mobilisés pour élire leurs représentants à l’Assemblée nationale (400 sièges) et dans les Assemblées provinciales, avec un taux de participation estimé à 58,64%. Une élection historique en revers pour le Congrès national africain (ANC, sigle en anglais), le parti au pouvoir qui, pour la première fois depuis trente ans, a perdu sa majorité absolue, récoltant ainsi 40,18% des voix.
![[Grand entretien] En Afrique du Sud, « l’héritage de Mandela commence à s’éroder lentement » 2 [Grand entretien] En Afrique du Sud, « l’héritage de Mandela commence à s’éroder lentement »](https://tamamedia.com/wp-content/uploads/2024/06/Le-president-sud-africain-Cyril-Ramaphosa-reelu-pour-un-second-mandat-1024x576.jpg)
Ne disposant pas de majorité à l’Assemblée nationale et ayant besoin du soutien des autres formations politiques, l’ANC a démarché d’autres partis d’opposition. De ces pourparlers, l’African National Congress de Nelson Mandela est parvenu à conclure un accord avec son principal rival, l’Alliance démocratique (DA), crédité de 21,81% des suffrages exprimés. Grâce à cette alliance de circonstance imposée par les électeurs, en désillusion, le président sortant Cyril Ramaphosa a pu finalement être réélu, vendredi 14 juin, pour un second mandat par la nouvelle Assemblée nationale, mais, cette fois, pour former un gouvernement d’union nationale.
En Afrique du Sud, « un gouvernement de coalition existe lorsque deux ou plusieurs partis politiques (ou représentants indépendants) combinent leurs voix au sein d’une législature ou d’un conseil, pour élire un gouvernement et soutenir les décisions qu’il prend », explique le South African Government dans une note conceptuelle consultée sur son site internet.
Ce qui signifie que le Mouvement nationaliste indépendantiste d’Afrique du Sud, fondé en 1912 puis rebaptisé ANC depuis 1994, ne règne plus politiquement en maître absolu aux destinées de la Nation arc-en-ciel pendant ce mandat du successeur de Jacob Zuma (2009-2018). La nouvelle formation dissidente de l’ex-président destitué (uMkhonto We Sizwe, le MK) est devenue la troisième force politique avec 14,58%, en supplantant ainsi les Combattants pour la liberté économique (EFF) de Julius Malema se positionnant avec 9,52% comme la quatrième force nationale, selon les résultats complets compulsés de la Commission électorale sud-africaine (IEC, sigle en anglais).
Grand Entretien : Le chercheur et spécialiste en résolution des conflits Patrick Hajayandi analyse, pour Tama Média, les leçons à retenir de ces élections et ce que la formation d’un gouvernement d’union nationale pourrait changer dans la politique intérieure et étrangère du pays et notamment dans le dossier israélo-palestinien.
![[Grand entretien] En Afrique du Sud, « l’héritage de Mandela commence à s’éroder lentement » 3 photo patrick hajayandi2796235878422196386](https://tamamedia.com/wp-content/uploads/2024/06/photo-patrick-hajayandi2796235878422196386-1024x757.jpg)
L’invité de Tama Média : Patrick Hajayandi est chef de projet à l’Institut pour la Justice et la Réconciliation (IJR), une organisation basée en Afrique du Sud, et auteur de nombreux ouvrages sur la paix et la réconciliation en Afrique.
Qu’est-ce que les autres pays africains, surtout francophones, peuvent apprendre de l’expérience démocratique sud-africaine ?
L’expérience sud-africaine a beaucoup de choses à apprendre aux pays francophones dont la gouvernance est parmi les plus mauvaises. Il s’agit avant tout de l’importance d’avoir des institutions fortes et stables, qui ne sont pas contrôlées par les pouvoirs publics.
En Afrique du Sud, la commission électorale (IEC) jouit d’une certaine indépendance et cela lui permet d’organiser des élections où la crédibilité est difficile à mettre en doute grâce à l’aspect inclusif de son personnel et à la transparence dont il fait preuve. L’indépendance de la justice constitue un facteur limitant les activités illégales auxquelles les hommes politiques peuvent s’adonner.
Bref, les principes démocratiques sont bel et bien une réalité et cela permet à la société sud-africaine de s’exprimer sur les maux du pays sans crainte de représailles. Ce qui fait que la classe politique (gouvernement et opposition) est poussée à réfléchir à des solutions aux différents problèmes du pays.
Vous travaillez pour l’Institut pour la Justice et la Réconciliation (IJR). Peut-on dire aujourd’hui que les Sud-Africains se sont vraiment réconciliés, trois décennies après la fin de l’apartheid ?
Après 30 ans de démocratie, il est toujours difficile de dire que les différentes races se sont réconciliées en Afrique du Sud. Tout d’abord, il y a des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) qui n’ont pas été mises en application. Il s’agit notamment de celles concernant les réparations. Aujourd’hui, l’Afrique du Sud reste l’un des pays les plus inégalitaires sur la planète.
En plus, les Blancs, qui représentent la minorité, continuent d’avoir le contrôle sur les principaux leviers de l’économie comme le secteur bancaire, l’agriculture, le commerce. Alors que la grande partie des Noirs, qui sont majoritaires, continuent de croupir dans la pauvreté malgré l’émergence d’une petite classe moyenne noire. C’est à cause de ces facteurs que certains jeunes sud-africains condamnent aujourd’hui le « deal » qu’a conclu Nelson Mandela avec le National Party de Frederik De Klerk (dernier président sous l’apartheid, NDLR). Il s’agissait de donner aux Noirs le pouvoir politique et de laisser aux Blancs le pouvoir économique.
Or, il s’est avéré qu’avec l’argent, on arrive quand même à contrôler les hommes politiques. C’est ainsi que la plupart de ceux qui pouvaient prendre le devant pour apporter la justice aux Noirs ont été corrompus par l’argent et ont oublié les promesses faites aux pauvres. Le fossé entre les riches et les pauvres continue donc à constituer un frein majeur à la réconciliation raciale en Afrique du Sud.
Nelson Mandela, en tant que premier président charismatique de l’Afrique du Sud post-apartheid, a dessiné les contours de ce que devait être la Nation arc-en-ciel. Que reste-t-il aujourd’hui de l’héritage de Madiba ?
L’héritage de Mandela commence à s’éroder lentement. À son époque, les Noirs voulaient se libérer du joug de l’apartheid. Cela avait constitué le cheval de bataille de lui et de ses compagnons comme Walter Sisulu, Oliver Thambo, Robert Sobukwe, Albert Luthuli.
Avec la fin de l’apartheid, le combat des jeunes générations a changé. Les soucis des jeunes qui n’ont pas connu cette icône nationale sont surtout liés à la recherche d’emploi, à pouvoir s’assurer un lendemain meilleur, et cela dépend de la classe politique aux commandes et des décisions qu’elle va prendre pour élever la société.
Mandela reste certes une figure emblématique et unificatrice, mais la « Magie Mandela » disparaît car les jeunes ont besoin de nouveaux héros – ceux capables de résoudre le problème persistant des inégalités et de la pauvreté.
Le président Cyril Ramaphosa s’est fait remarquer par son activisme pour faire condamner Israël pour “génocide” à Gaza devant la Cour Internationale de Justice. Est-ce que ce soutien aux Palestiniens est une cause partagée en Afrique du Sud ?
La condamnation d’Israël par le gouvernement sud-africain représente une position du Congrès national africain qui gouverne le pays. L’ANC estime que la cause des Palestiniens est aussi importante que sa lutte contre l’apartheid. Le parti EFF (les Combattants pour la liberté économique) de Julius Malema partage aussi cette position. Cela n’est pas surprenant car les deux partis ont en réalité une même origine.
Mais ce n’est pas une position partagée par tous les Sud-Africains. Il faut rappeler que l’Afrique du Sud a une diaspora juive assez importante. Cette partie de la population n’est pas en accord avec la position du gouvernement qui est en réalité celle de l’African National Congress (ANC). De plus, il y a une grande majorité de la population que la politique étrangère du gouvernement n’intéresse pas réellement et qui ne savent même pas ce qui se passe entre les deux pays.
Pourquoi donc l’Afrique du Sud est-elle presque la seule à critiquer ouvertement Israël alors que d’autres dirigeants africains optent pour une position réservée ?
Les autres pays africains ne partagent pas nécessairement cette vision (de l’ANC, NDLR), d’où leur position réservée. La domination de la religion chrétienne dans certains pays africains pourrait expliquer leur position sur cette question. D’autres dépendent des sponsors des pays occidentaux, notamment des États-Unis, principal soutien d’Israël.
En décembre 2023, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), dont l’Afrique du Sud est membre influent, a envoyé une mission militaire pour aider à stabiliser la République démocratique du Congo (RDC). Vous qui êtes un spécialiste en résolution des conflits, quel rôle l’Afrique du Sud et la SADC peuvent jouer pour mettre fin au conflit entre la RDC et le Rwanda voisin, accusé de soutenir le mouvement armé M23 ?
Normalement, la SADC pourrait jouer un rôle de médiateur entre les parties en conflit. Elle en a les moyens. Mais, étant donné que la RDC est aussi membre de cette organisation, son rôle primordial est d’apporter un soutien militaire à un de ses pays membres en difficulté comme cela est stipulé dans son Pacte de défense de 2003.
Toutefois, la Communauté de développement de l’Afrique australe éprouve des difficultés, en ce moment, à cause du nombre croissant des États membres qui rencontrent des difficultés à plusieurs niveaux. Le Mozambique, par exemple, est confronté aux insurgés islamistes (du groupe Ansar al-Sunna, NDLR) qui ont prêté allégeance à l’État Islamique (EI). La SADC a été appelée à donner un appui militaire à ce pays mais il y a eu peu de pays membres en mesure de mettre des troupes à la disposition de l’organisation. Les pays comme le Zimbabwe et le Malawi sont en proie à des difficultés économiques et ont aussi besoin de soutien. Ces différents défis diminuent l’ampleur de l’intervention de la SADC en RDC, ce qui fait qu’on ne voit pas réellement de progrès sur le terrain.

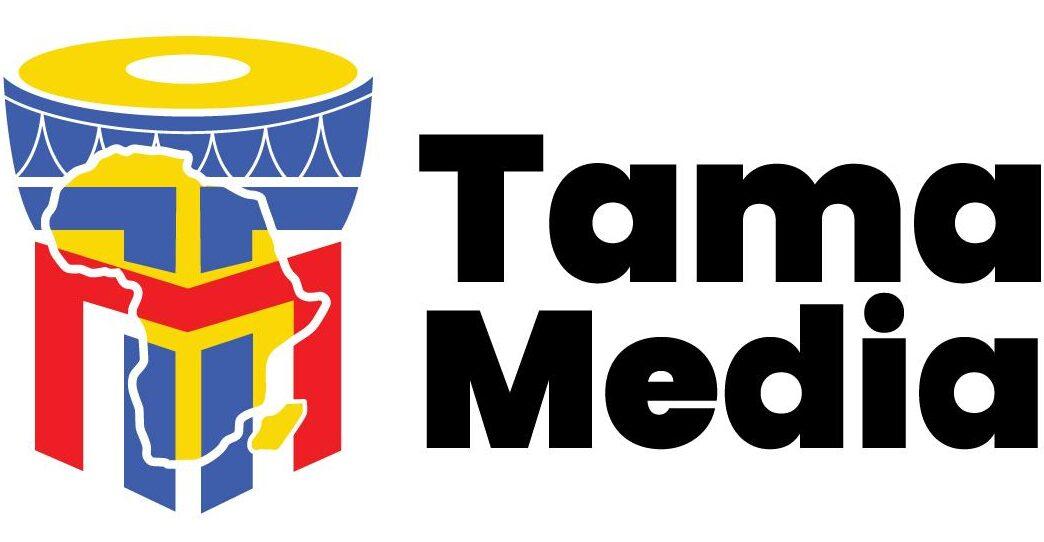
![[Grand entretien] En Afrique du Sud, « l’héritage de Mandela commence à s’éroder lentement » 1 photo patrick hajayandi2796235878422196386](https://tamamedia.com/wp-content/uploads/2024/06/photo-patrick-hajayandi2796235878422196386-1200x887.jpg)



