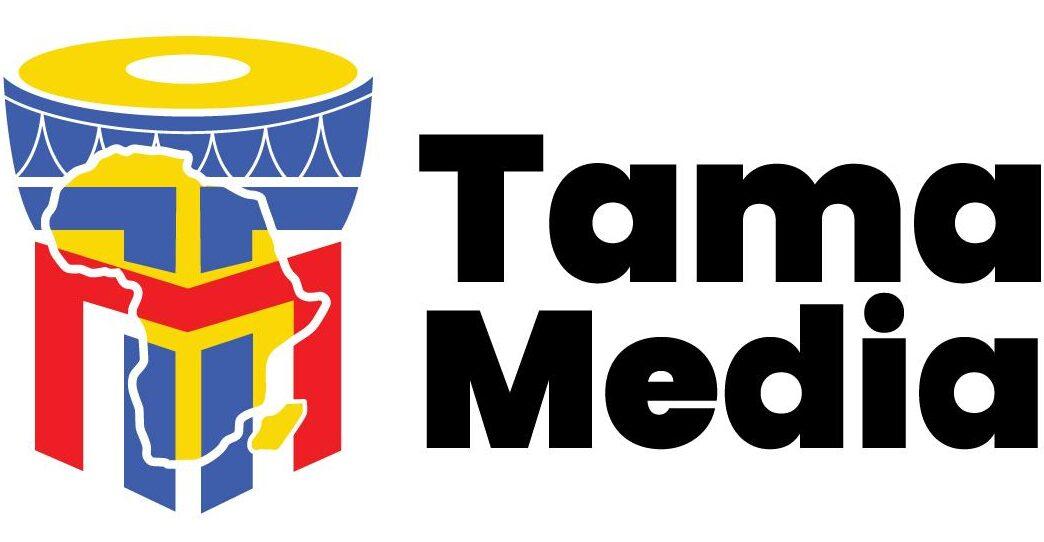C’est reparti, depuis le 7 octobre 2023, pour un énième épisode de violences extrêmes au Proche-Orient avec Israël et la Palestine comme acteurs principaux. Les attaques mortelles du Hamas contre l’État hébreu ont mis le feu aux poudres. Sur le continent africain, face à ce regain de tension, une poignée de pays refusent pourtant de condamner le Hamas et réitèrent même leur soutien indéfectible à la cause palestinienne.

Le réveil du 7 octobre dernier, dans plusieurs localités d’Israël, a été apocalyptique. Ce samedi-là, au petit matin, de manière coordonnée, des combattants bien entraînés et lourdement armés du Hamas ont pénétré dans le territoire réputé hyper protégé pour y répandre le sang. Bilan provisoire : plus de mille morts. Du jamais vu en 75 ans d’existence de l’État hébreu !
Pour se venger de ces attaques sans précédent sur son sol, Israël pilonne depuis lors le fief du Hamas, mobilise toute son armée ainsi que ses réservistes et masse ses chars d’assaut à la frontière avec l’enclave palestinienne en vue d’une opération terrestre d’envergure inédite. La force de frappe de Tsahal a déjà causé près de 2000 morts dans la bande de Gaza avec l’utilisation d’au moins 4000 tonnes d’explosifs. Un déluge de feu qui a poussé les civils palestiniens à se réfugier dans la partie Sud de cette région surnommée « la prison à ciel ouvert » pour 2,3 millions d’habitants sur une superficie de 380 km².
La « neutralité active » de l’UA
La guerre est lancée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou avec entre autres la bénédiction des États-Unis et de l’Europe, les alliés historiques qui reconnaissent à Israël le droit de se défendre comme il se doit face aux « actes terroristes » du Hamas. « L’Europe a un problème moral, une dette vis-à-vis des juifs à cause de la Shoah (leur massacre dans le vieux continent, NDLR) durant la seconde guerre mondiale (1939-1945). Aux États-Unis, le lobby juif est très puissant. Dans le pays de l’oncle Sam, le soutien à Israël est une doctrine surtout à l’approche des élections », analyse pour Tama Média le Professeur Babacar Samb, enseignant-chercheur au département d’arabe de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar.
En Afrique, la question divise. « À la différence par exemple de la Ligue arabe qui s’est réunie au Caire (Égypte) au lendemain des attaques du Hamas en Israël pour se concerter et arrêter une position commune, l’organisation faîtière du continent n’a pas tenu de réunion d’urgence, ni en présentiel ni en ligne. Le président de la Commission de l’Union Africaine (UA) a certes publié un communiqué, mais d’après les termes utilisés, celui-ci correspond à l’énoncé classique d’une neutralité active dans la mesure où les parties au conflit sont invitées à la retenue et à la reprise des négociations. Les États membres ont donc l’entière liberté d’afficher leurs positions. Dans ces conditions, un consensus est difficile à dégager », explique à Tama Média le Professeur des universités Lat Soucabé Mbow, chercheur en géopolitique.
En effet, Moussa Faki Mahamat a exprimé « sa plus vive préoccupation au sujet du déclenchement de la guerre aux très graves conséquences sur la vie des civils israéliens et palestiniens et sur la paix dans la région ». Le diplomate tchadien a aussi rappelé que « la dénégation des droits fondamentaux du peuple palestinien, notamment celui d’un État indépendant et souverain, est la cause principale de la permanente tension ».
En outre, le président de la Commission de l’organisation panafricaine a lancé « un appel pressant aux deux parties afin de mettre fin aux hostilités militaires et de revenir, sans conditions, à la table de négociations pour la mise en œuvre du principe des deux États vivant en harmonie dans l’intérêt des peuples palestinien et israélien » et interpellé « la communauté internationale, les grandes puissances mondiales en particulier, à prendre leurs responsabilités pour imposer la paix et garantir les droits des deux peuples ». Loin de ce jeu d’équilibriste, des pays africains ont choisi leur camp : la Palestine.
Le poids de la religion
À ce jour, sept États du continent africain refusent catégoriquement de condamner les attaques du Hamas et/ou leur trouvent des circonstances atténuantes. Il s’agit de l’Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie, du Soudan, de la Libye, de Djibouti et de l’Afrique du Sud.
Alger, à travers une communication de son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a constaté « avec une profonde inquiétude l’escalade des agressions sionistes barbares contre la bande de Gaza, qui ont coûté la vie à des dizaines d’innocents enfants du peuple palestinien, tombés en martyrs face à l’entêtement de l’occupation sioniste dans sa politique d’oppression et de persécution imposée au vaillant peuple palestinien ».
Poursuivant, le chef de la diplomatie algérienne a demandé aux instances internationales d’intervenir « pour protéger le peuple palestinien contre la brutalité et la criminalité qui sont devenues la marque de fabrique de l’occupation sioniste des territoires palestiniens » et à œuvrer au « respect des droits nationaux légitimes du peuple palestinien et l’établissement de son État indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Qods (Jérusalem) pour capitale ».
Tunis a exhorté « toutes les consciences vivantes du monde à se tenir aux côtés du peuple palestinien et à se souvenir des massacres perpétrés par l’ennemi sioniste contre notre peuple arabe en Palestine ». Le pays dirigé par le nationaliste arabe Kaïs Saïed a renouvelé son « soutien total et inconditionnel au peuple palestinien », non sans affirmer qu’il a « le droit » de récupérer la bande de Gaza, « sous occupation sioniste depuis des décennies », au même titre que « toute la terre de Palestine ».
Nouakchott, quant à elle, a soutenu que les heurts sont « le résultat logique des provocations continues et des violations régulières des droits du peuple palestinien et du caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa par les autorités d’occupation israéliennes, en plus de la poursuite de l’expansion des colonies ».
En 2021, Pretoria s’est farouchement opposée à l’octroi à Israël du statut de membre observateur au sein de l’Union Africaine. « Nous sommes inébranlables dans notre engagement en faveur de la lutte pour la liberté du peuple palestinien », a réagi le Congrès National Africain (ANC, sigle en anglais) au déclenchement des hostilités. Le parti de Nelson Mandela, au pouvoir, a aussi dit que la détérioration de la paix « est directement liée à l’occupation illégale par Israël de la Palestine ». Une situation qu’il assimile à l’apartheid, régime de ségrégation raciale aboli le 30 juin 1991.
L’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Soudan, la Libye et Djibouti « tiennent compte de leur opinion publique. Ils défendent la cause palestinienne en raison de la mosquée Al-Aqsa », souligne le Professeur Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte. Construite au 7e siècle à Jérusalem, elle est le troisième lieu saint de l’Islam après la Mecque et Médine (Arabie saoudite). En ce qui concerne l’Afrique du Sud, son attitude face au conflit israélo-palestinien, ajoute l’enseignant-chercheur, est due au fait que « tous les pays ayant connu la colonisation ou d’autres types de domination devraient en principe soutenir la création de l’État de la Palestine. Ce serait vraiment incompréhensible de les voir prendre la défense d’Israël ».
Au final, indique le Professeur Mbow, par ailleurs agrégé de géographie, « les soutiens à la cause palestinienne varient avec le temps. Lorsque la répression touche les civils à Gaza ou les territoires occupés en Cisjordanie, des marques de soutien immédiates sont enregistrées autant au niveau gouvernemental qu’au sein des opinions publiques. Il arrive dans beaucoup de cas que le mutisme des autorités étatiques soit l’expression d’un embarras des dirigeants par crainte d’aller à contre-courant de la rue plus favorable aux arabes de Palestine, notamment dans les pays africains majoritairement musulmans. Mais dans la durée, il n’est pas rare d’assister à une baisse d’intensité du soutien aux Palestiniens. Ce qui peut expliquer la mauvaise volonté mise depuis 1967 par Israël dans le respect du droit international et des résolutions des Nations Unies ».