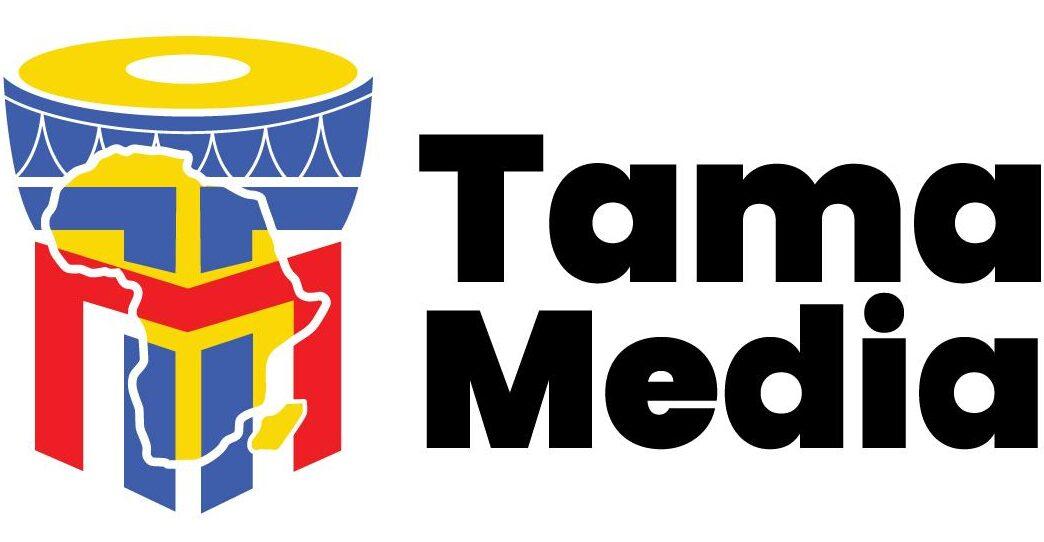La nouvelle est tombée avec fracas le dimanche 28 janvier 2024. À travers un communiqué conjoint, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, trois pays du Sahel aux destins liés par la lutte contre le jihadisme, rompent les amarres avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les implications d’une telle décision ?

[Grand Entretien] : Ibrahima Kane, chargé des questions relatives aux institutions régionales et continentales à Open society initiative for West Africa (Osiwa), jette un regard transversal sur ce nouvel épisode d’un long feuilleton.
Tama Média : Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont récemment annoncé leur retrait « sans délai » de la Cédéao. Est-ce qu’il y avait des signes avant-coureurs ?

Ibrahima Kane : On a, en tout cas, noté des signes annonciateurs d’une radicalisation. Mais on ne pensait pas que ça pouvait aller jusqu’à un retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).
La mission que la Cédéao devait effectuer au Niger, il n’y a pas longtemps, est tombée à l’eau. La Commission de l’organisation régionale disait avoir rencontré un problème d’avion à partir d’Abuja, au Nigeria. Cet évènement a suscité le courroux des autorités nigérianes.
Il y a toujours eu des différends portés sur la place publique entre le Mali et la Cédéao. Idem pour le Burkina Faso. Ces pays avaient commencé à s’organiser en créant avec le Niger l’Alliance des États du Sahel (AES).
En fait, ils étaient à la recherche de nouvelles stratégies car les sanctions prononcées à leur encontre par la Cédéao ont provoqué des effets dévastateurs. Récemment, ces pays ont engagé des missions à l’étranger notamment en Russie. La semaine dernière, un haut représentant de Moscou était à Ouagadougou. À partir de tous ces éléments, on peut avoir une certaine idée de ce qui se tramait.
Une chose me semble tout de même correcte dans la démarche de ces trois pays. C’est de dire que la Cédéao n’a absolument rien fait pour la résolution de la crise sécuritaire. Au Liberia et en Sierra Leone, la Cédéao, particulièrement le Nigeria, était intervenu. On n’a pas vu cela au Mali, au Burkina et au Niger qui luttent contre le jihadisme.
Il semblerait que la Cédéao avait adopté une stratégie qui devait être approuvée par les chefs d’État et de gouvernement, mais ça n’a pas été le cas à cause de l’influence des puissances occidentales qui préféraient mettre sur pied le G5 Sahel.
J’espère que la Cédéao va revoir sa copie. Au nom de la solidarité communautaire, à défaut de contribuer par les hommes, il faut fournir à ces pays des armes et d’autres moyens logistiques utiles dans le combat contre le terrorisme.
Ces trois pays sont actuellement dirigés par des juntes qui subissaient la pression de la Cédéao pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel. Comment analysez-vous leur retrait sous ce rapport ?
Ils veulent imposer à la Cédéao leurs propres agendas de transition. Depuis que le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de cheminer ensemble, c’était ça leur stratégie. Ils ont les mêmes préoccupations. La Cédéao a demandé aux militaires d’organiser rapidement les transitions politiques, mais les militaires tablent sur plusieurs années avant d’y arriver.
Le principal problème entre les dirigeants de ces pays et la Cédéao a trait à la durée des transitions. C’est difficile de parvenir à un accord avec l’organisation régionale. Par conséquent, je pense que la décision de retrait est un moyen de pression. Si on en juge la réaction de la Cédéao, l’effet recherché a été atteint. Car elle s’est dite ouverte à la négociation.
Maintenant qu’ils sont ensemble, le Mali, le Niger et le Burkina constituent une force. Ils vont vouloir peser sur le processus décisionnel de la Cédéao. La Guinée, où les hommes en treillis sont aussi au pouvoir, surveille ce qui est en train de se passer.
J’estime que le moment du retrait est bien choisi. Au sein du bloc des pays de la région intransigeants sur le respect de l’ordre constitutionnel, des fissures ont vu le jour. Au Bénin par exemple, le président Patrice Talon, à cause du manque à gagner par rapport aux importations nigériennes, avait commencé à dire qu’il était prêt à rouvrir ses frontières. Le Togo voisin profitait largement de la situation. Beaucoup de marchandises à destination du Niger passaient, paraît-il clandestinement, par Lomé.
En outre, au Nigeria, des pressions sont exercées sur le président Bola Tinubu. Dans le Nord de l’État fédéral, les habitants plaident pour la levée totale des sanctions contre le Niger ou tout au moins leur allègement. Les autorités locales ont fait énormément de plaidoyers pour porter auprès du pouvoir central la voix des populations identiques installées de part et d’autre de la frontière.
Quelle est la part de responsabilité de la Cédéao dans la décision de retrait. Certains invoquent notamment la menace d’intervenir militairement au Niger. Qu’en dites-vous ?
C’est une erreur stratégique de Bola Tinubu, le président en exercice de la Cédéao. Avant de prendre une décision aussi extrême, il devait contacter l’auteur du putsch au Niger pour connaître ses motivations. Il fallait avoir une vue claire de ce qui se jouait à l’interne, mais aussi de l’impact de cette crise dans la sous-région.
Et après tout, le Niger est frontalier du Nigeria dans sa partie septentrionale. À mon sens, je ne pense pas qu’il aurait agi de la même façon s’il avait toutes les informations détenues aujourd’hui.
Le raidissement des militaires est lié à la fermeture des portes, fenêtres et trous par la Cédéao. C’est une erreur politique majeure de Tinubu, mais également une faute de la Commission de la Cédéao. Son rôle est d’aider à prendre des décisions, de mettre sur la table toutes les hypothèses sur lesquelles les chefs d’État et de gouvernement peuvent travailler dans l’intérêt de la région.
La Commission de la Cédéao a brillé par son incapacité à penser à d’autres solutions que celles de la prise de sanctions. Vouloir sauver le président Mohamed Bazoum ou détruire la Cédéao, le choix était vite fait. Le président nigérien déchu n’est toujours pas libre de ses mouvements et la Cédéao risque de payer très cher le prix de ses errements dans cette crise politique et au Sahel en général.
Un retrait avec effet immédiat est-il possible ? Que disent les textes de la Cédéao ?
C’est l’article 91 du Traité révisé de la Cédéao qui évoque cette question. Il donne la possibilité à tout État membre de quitter l’espace communautaire. Cet article précise également que si l’État maintient sa décision de retrait, l’acte serait effectif un an après la formulation de la demande.
Toutefois, à tout moment durant cette période, l’État peut revenir sur sa décision. Le texte est assez flexible pour permettre la négociation entre les dirigeants de la Cédéao d’une part, le Mali, le Burkina et le Niger d’autre part, en vue de trouver un consensus.
Cela dit, les textes de la Cédéao sont très clairs à propos d’un État sur le territoire duquel s’est produit un coup d’État. Dès lors, il est intéressant d’observer l’attitude de la Cédéao par rapport aux transitions dans ces pays.
Je vois mal l’organisation régionale renoncer aux principes qui ont toujours été à la base de la communauté pour simplement satisfaire les desiderata de militaires. Il faut néanmoins écouter ces putschistes pour savoir ce qu’ils veulent. Ils sont à la tête de pays ayant signé tous les textes de la Cédéao.
On doit se demander ce qu’on peut faire pour eux dans le respect des textes actuels. Il y a eu des erreurs d’appréciation de la situation, des décisions ont été prises à la va-vite, mais il est possible de les corriger.
Cette crise montre, au-delà de tous ces aspects, qu’il faut régler en Afrique de l’Ouest le problème des militaires et du pouvoir. Le protocole de la Cédéao sur la bonne gouvernance dit que la place des militaires est dans les casernes.
Au Nigeria, les militaires sont de moins en moins visibles. Mais au Burkina Faso, depuis 1966, ils sont aux commandes. Au Mali, c’est le cas depuis 1968. Depuis 1974 au Niger. Au Togo, depuis 1967. Le Bénin a connu une longue période de militaires au pouvoir.
En réalité, les militaires se sont habitués à l’exercice du pouvoir. Il est indispensable d’engager une discussion sérieuse sur la place des militaires dans nos pays. La Cédéao doit s’y employer.
Une sortie du Mali, du Burkina et du Niger de la Cédéao peut même avoir une incidence sur leur participation au fonctionnement de l’Union Africaine (UA). C’est l’appartenance à l’Afrique de l’Ouest qui permet à ces pays de siéger à l’UA.
Tout se fait à partir des cinq communautés économiques régionales que compte le continent. La Cédéao est une seule région. L’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) n’est pas représentée au niveau de l’organisation panafricaine.
Les juntes malienne, nigérienne et burkinabè disent agir dans l’intérêt de leurs populations. Comment sortir d’un espace communautaire, où était garantie la libre circulation des personnes et des biens, peut être une bonne nouvelle pour les citoyens concernés ?

Sur la question de la libre circulation des personnes et des biens, il y a trois choses à clarifier. Premièrement, la mesure de retrait de la Cédéao n’est pas immédiate. Jusqu’en janvier 2025, les populations nigériennes, maliennes et burkinabè pourront encore se déplacer sans entrave au sein de l’espace communautaire.
Deuxièmement, ces trois pays appartiennent à l’Uemoa où s’applique aussi des règles de libre circulation des personnes et des biens. Et jusque-là, ils n’ont pas décidé de quitter l’Uemoa.
Troisièmement, les différends avec la Cédéao ont montré que du point de vue économique, le Burkina et le Niger commerçaient beaucoup entre eux. C’est d’ailleurs ce qui a permis d’atténuer les effets des sanctions. Le Mali, par contre, échange énormément avec le Sénégal. Pour le moment, ils s’en sortent tant bien que mal. Étant donné que ce sont des pays dépourvus de façade maritime, la situation sera difficile à supporter sur le long terme.
Ces trois pays avaient aussi montré quelques réserves par rapport au franc CFA. On peut donc se demander s’ils sont prêts à quitter l’Uemoa. Ce serait la quadrature du cercle. Battre leur propre monnaie, essayer d’avoir des accords avec les pays voisins pour la libre circulation des personnes et des biens, c’est énormément de choses que les militaires au pouvoir dans ces pays sont incapables de gérer parce que déjà confrontés à des défis sécuritaires immenses.
Avec ces retraits de la Cédéao, l’intégration dans la région ouest-africaine prend un sacré coup. Peut-on toujours parler de l’Afrique des grands ensembles ?
On manque de dirigeants visionnaires. On ne peut pas avancer dans l’intégration si l’outil qui doit la permettre n’est pas efficace, n’a pas les moyens de sa politique. Or la Commission de la Cédéao, depuis plus d’une quinzaine d’années, fait l’objet de réformes qui n’aboutissent jamais. Au cours de la 63e Session de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao, en juillet 2023, ces réformes ont été évoquées.
Tant qu’il y a instabilité au sein de l’organisation, ce sera difficile d’atteindre certains résultats. À la Cédéao, depuis quinze ans, quand le président de la Commission s’en va, toute l’équipe l’accompagne. Ils ne sont nommés que pour un seul mandat. En quatre ans, comment voulez-vous qu’une équipe puisse effectuer un travail de fond et consolider ce qui a été réalisé par l’équipe précédente. C’est juste impossible.
Mohamed Ibn Chambas a fait deux mandats de cinq ans. C’est pourquoi il est resté dans la mémoire des populations de la Cédéao. Il a eu le temps de travailler. On ne peut pas hélas en dire autant aujourd’hui. Maintenant, c’est un seul mandat de quatre ans. Et c’est toute l’équipe qui est changée. Il manque une mémoire institutionnelle. Il n’y a pas de continuité.
Une organisation comme la Cédéao, qu’on le dise ou pas, a vraiment aidé la région à avancer. Avec une carte d’identité, vous pouvez circuler dans l’espace communautaire et travailler dans n’importe quel pays. C’est un progrès remarquable. Le concept de citoyenneté régionale, que les Européens ont porté à un haut niveau, est une création de la Cédéao. Elle a vu le jour en 1982. L’Europe l’a copié en 1992.
Par rapport au financement des institutions, la Cédéao a été la première en Afrique à dire qu’il fallait faire en sorte que les États ne soient plus obligés d’amener des sous. Elle est la seule organisation africaine qui finance à 95 % ses activités. Les partenaires étrangers ne participent qu’à hauteur de 5 % au budget de la Cédéao. Cela prouve qu’on ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites.
La question fondamentale est de savoir comment procéder pour régler les problèmes actuels. On doit mettre la région à l’abri des luttes d’influence entre l’Occident et les autres puissances étrangères comme la Chine, la Russie ou la Turquie. C’est ce qui est en jeu.
Ces pays du Sahel ont tourné le dos à la France. Ils ouvrent grandement leurs portes à la Russie, à la Turquie et l’Iran. Le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine est allé, fin janvier 2024, en visite à Téhéran. C’est un retournement d’alliance qui est en train de s’opérer. Ces pays quittent une zone d’influence pour aller dans une autre.
Puisque l’agenda de la Cédéao est un agenda panafricain, on doit utiliser cette idéologie pour contrer la volonté de domination des puissances étrangères. Il faut se battre pour que l’Afrique de l’Ouest appartienne aux Ouest-Africains. Malheureusement, ce n’est pas à l’ordre du jour dans les combats des militaires. Ces derniers veulent simplement rester aux affaires.