
La foire dédiée aux scènes artistiques d’Afrique et ses diasporas, Akaa (Also Known as Africa), est revenue pour sa septième édition du 20 au 23 octobre 2022 au Carreau du Temple à Paris. L’occasion pour les collectionneurs ou les amateurs d’art de voir les œuvres d’artistes phares et de découvrir les noms montants de la scène contemporaine africaine.
Parmi les 150 artistes venus de 30 pays et les 38 galeries présentes, nous avons sélectionné pour vous douze coups de cœur à suivre absolument.
Barbara Asei Dantoni
Barbara Asei Dantoni est une artiste et designer franco-italo-camerounaise travaillant entre la France et le Cameroun. A travers des créations protéiformes, l’artiste interroge les symboles liés à ses ancêtres et à sa féminité. Elle parle des histoires d’exil, de migration et des identités fragmentées qui la constituent.

Leslie Amine
D’origine franco-béninoise, Leslie Amine s’intéresse aux questions du métissage, d’hybridité et d’identité. Son travail se construit au rythme de ses déplacements dans le monde, c’est sur d’autres continents qu’elle va le plus souvent puiser son inspiration.

Jomo Tariku
Jomo Tariku est un artiste et designer industriel éthiopien américain, est un pionnier du design africain moderne. Destinés à être des pièces d’héritage à célébrer et à apprécier pour les générations à venir, les motifs envoûtants de Jomo insufflent chaleur et vitalité aux espaces de vie.
Leila Rose Fanner
Née en Californie et élevée dans une petite ville d’Afrique du Sud, Leila Rose Fanner s’inspire dans son travail de fantaisies féminines, des marchés vintages, des photographies d’art botanique, de la mode, des films d’art japonais, de la philosophie spirituelle, de l’art nouveau et de l’art populaire africain.
Chantaléa Commin
Chantaléa Commin est un artiste multimédia d’origine africaine, indou et amérindienne. Native de Guadeloupe, ses œuvres qui mêlent critique sociale et motifs imaginaires, portent sur les rapports de domination centrés sur les sociétés noires.
Willow Evann
Originaire de la Côte d’Ivoire, Willow Evann est un artiste protéiforme aux influences multiples, danseur, plasticien, sculpteur et photographe. Si la captation du geste et du mouvement chorégraphique est au centre de sa pratique artistique, Willow Evann s’interroge en tant qu’artiste plasticien sur la construction de l’image et du statut social des personnes noires évoluant dans les sociétés occidentales.
Richmond Agamelah
Richmond Agamelah est un artiste Ghanéen fasciné par la peinture. Comme les acteurs d’une tragédie shakespearienne, ou les légendes du folklore africain, les personnages d’Agamelah occupent un espace pour jouer leur rôle dans un récit artistique plus large.
Tesprit
Tesprit (de son vrai nom Foli Kossi Gérard Tete) est un jeune artiste togolais pluridisciplinaire. Sa particularité est de travailler avec des semelles de tongs usées qu’il taille et découpe pour créer de grandes toiles figuratives à l’esthétique surprenante. Une démarche responsable et originale qui dénonce de surcroît les conditions de vie des enfants des rues de Lomé.
Victor Olaoyé
Victor Olaoyé, artiste nigérian, explore les relations entre identités personnelles et cultures ethniques, notamment au-travers du textile Adire teint à l’indigo. Il contribue à réinventer les cultes traditionnels, ravivés depuis les années 60 aux USA par les mouvements Black Power. Toutes les hiérarchies de l’espace culturel de ses figures inséparables de ce matériau, dépendent des variations corrélées à ce textile.
Ousmane Bâ
Artiste franco-sénégalais, la spontanéité et la gestuelle des corps au cœur de sa démarche artistique confèrent à ses œuvres une apparente simplicité. Décortiquant sa fascination pour l’exotisme et les couleurs d’orients, sa pratique picturale et graphique s’inscrit dans une recherche esthétique en dialogue avec la modernité des avant-gardes du début du XXe siècle.
Tafadzwa Masudi
Tafadzwa Masudi est un artiste zimbabwéen. Ses peintures aux couleurs vives représentent des scènes remplies de ballons, de personnages et de motifs. Observés à travers le prisme d’une personne migrante existant dans un pays étranger, les travaux reflètent l’optimisme et la poursuite d’un avenir meilleur.
Artiste invité d’honneur, Abdoulaye Konaté
Abdoulaye Konaté, artiste malien, est l’une des grandes figures des arts plastiques en Afrique. Abordant la tapisserie, la confection, la peinture et la sculpture, il fait du tissu son principal matériau de création. Son travail dégage deux grandes directions. La première, aborde différentes thématiques liées à la société contemporaine et à la condition humaine, avec une vision critique des enjeux socio-politiques. La seconde, purement esthétique et plastique le pousse à s’interroger sur l’analyse des rapports entre les couleurs, associant modernisme occidental et symbolique africaine.

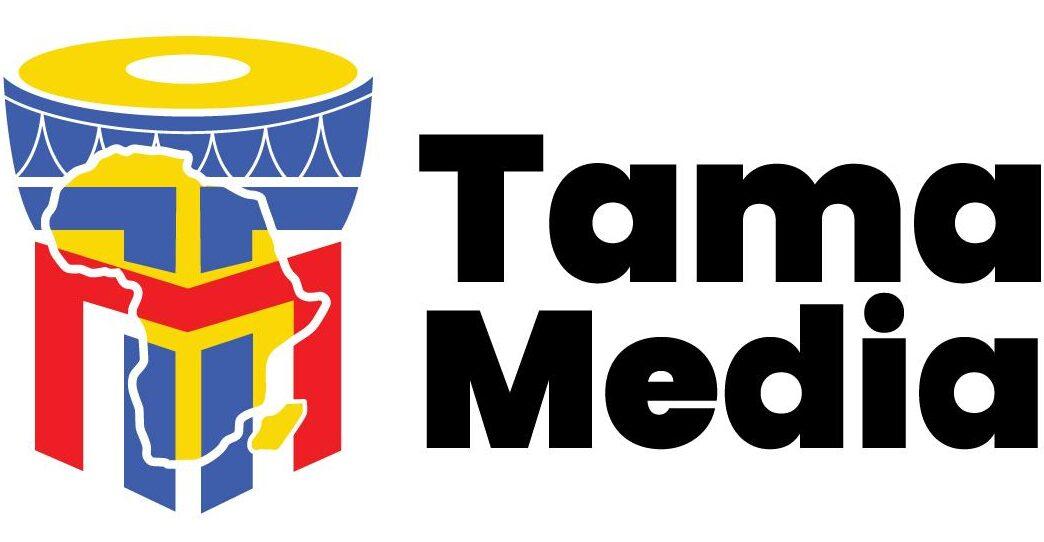

![[Grand Entretien] Hezbollah : les racines cachées d'une influence grandissante en Afrique de l’Ouest 16 Le Hezbollah en Afrique : les racines cachées d'une influence grandissante en Afrique de l’Ouest](https://tamamedia.com/wp-content/uploads/2024/10/Hezbollha-Afrique.webp)



