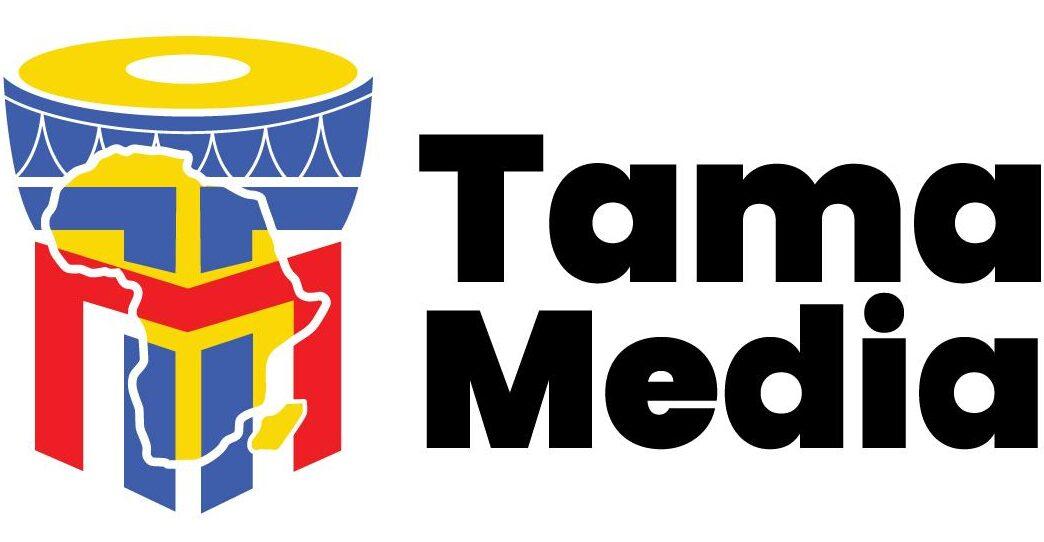Neuf ans après la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation (APR), issu du processus d’Alger, les autorités de transition ont soutenu avoir constaté son « inapplicabilité absolue ». En conséquence, elles ont annoncé, dans un document officiel du 25 janvier, « sa fin, avec effet immédiat ». Le régime dirigé par le colonel Assimi Goïta a opté pour un dialogue inter-malien, sans médiation internationale, « afin d’éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires ». Mais quelles sont les chances de succès de l’accord qui accouchera de cet énième dialogue national ?

Par Baba Coulibaly
L’accord de paix d’Alger a été le fruit d’une médiation conduite par l’Algérie entre le gouvernement de l’ex-président Ibrahim Boubabcar Keita, avec l’actuel ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop occupant le même poste, et la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) – regroupant notamment le Mouvement de libération de l’Azawad (MLNA), le Haut conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) et le Mouvement arabe de l’Azawad (MAA). Outre ces deux parties prenantes, « d’autres mouvements proches du gouvernement malien ont créé la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger ». Ce qui en fait, dans une certaine mesure, une entente tripartite réalisée sous l’égide de la communauté internationale.
Sa dénonciation est intervenue après le départ effectif de la Minusma – qui demeurait jusqu’à son retrait acté membre de la médiation internationale garante de sa mise en œuvre – ainsi que la reprise de la ville de Kidal, le 14 novembre, par les Forces armées maliennes (Fama) et leurs partenaires militaires russes. Cette localité, dans le septentrion, près de la frontière avec Algérie, est considérée comme le fief des groupes rebelles indépendantistes, réunis ces derniers mois au sein du Cadre Stratégique Permanent pour la Paix, la Sécurité et le Développement (CSP-PSD). Lesquels sont qualifiés par le pouvoir militaire de Bamako comme « des terroristes » – à appréhender dans sa connotation fortement politique, qui « ne fait toujours pas l’objet d’une définition universellement admise en droit international » –, au même titre que les groupes jihadistes opérant dans le pays. Des cadres du CSP et du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (Gsim/Jnim) du Malien Iyad Ag Ghali, affilié à Al – Qaïda, sont ainsi poursuivis en théorie par la justice malienne, depuis fin novembre 2023, aux motifs entre autres de « semer la terreur ».
« C’était une fin programmée au regard de la volonté affichée des autorités de transition depuis leur arrivée au pouvoir, de réaligner la réponse de l’État malien au conflit interne qui l’oppose aux groupes armés signataires de l’Accord d’Alger »
Par voie de communiqué publié sur les réseaux sociaux, daté du 26 janvier et signé par son porte-parole Mohamed Elmaouloud Ramadane, le CSP a indiqué prendre « acte de la décision (…) de Bamako de prononcer la caducité de l’Accord » .
La coalition armée a aussi appelé « ses mouvements à revoir et actualiser leurs objectifs » et invité la communauté internationale « à assumer toutes ses responsabilités vis-à-vis du défi auquel la junte malienne expose toutes les parties, à la hauteur de son engagement soutenu et déterminant lors de (sa) signature », dénonçant par ailleurs les supposées « violations des droits de l’Homme » contre les populations dont elle tient pour responsable l’État central.
De l’avis de nombreux observateurs, la fin de cet accord était prévisible. « C’était une fin programmée au regard de la volonté affichée des autorités de transition depuis leur arrivée au pouvoir, de réaligner la réponse de l’État malien au conflit interne qui l’oppose aux groupes armés signataires de l’Accord d’Alger. La reprise de la ville symbole de Kidal a été l’élément qui a acté cette fin programmée. Le rapport de force, qui était jusque-là assez équivalent, penche désormais définitivement du côté de l’État alors qu’à sa signature, les parties étaient toutes affaiblies par le conflit ouvert », analyse pour Tama Média Fatim D. (prénom modifié), observatrice des dynamiques sociopolitiques au Mali.

Avant la reprise des hostilités en août 2023 entre certains de ces groupes considérés par moment anciennement rebelles et l’armée régulière, le Cadre stratégique permanent (CSP) – un des mécanismes chargés alors de l’application de l’Accord, différent en partie du CSP-PSD dont les combattants ont repris les armes – a quasiment été vidé de ses membres pour diverses raisons invoquées. « Le CSP a, pour ses membres, été une instance de circonstance qui n’a pas réussi à jouer son rôle fédérateur en interne et diplomatique en externe », a fait observer Mohamed Maïga, ingénieur des politiques sociales, dans une publication d’août 2023 de Tama Média. « Il aurait pu être une instance réellement inclusive, rassembleuse et porteuse de sens pour les populations de cette partie du territoire malien. Malheureusement, il a plutôt été une instance avec des rapports de forces très soutenus, des tensions internes et des jeux d’alliance creux et contre-nature. Le CSP n’a pas eu d’impact », a conclu le directeur du cabinet d’études Aliber Conseil intervenant au Mali, au Sénégal, aux Comores et en France.
C’est ce qui fait encore dire au jeune écrivain Ousmane Souleymane Ambacane, auteur entre autres du livre « Sanglots des mots » (éd. Prostyle, Bamako, 2023), que « les parties signataires avaient du mal à s’entendre. Avec la nouvelle orientation politique des autorités actuelles et le départ des forces d’interposition étrangères, il était évident qu’il y ait une tournure ». De ce fait, poursuit ce titulaire d’un master de recherche en littérature africaine se décrivant « observateur libre et indépendant », « l’Accord signé au moment où le gouvernement malien était en posture de faiblesse doit être revu ».
Quels sont les facteurs de la « faible longévité » de l’Accord d’Alger de 2015 ?
Outre le contexte dans lequel l’APR a été dénoncé, il convient de souligner que « plusieurs facteurs l’ont conduit dès le départ à une faible longévité ». De l’analyse de Fatim D., « parmi ces facteurs, il y a son contenu qui a été mal vulgarisé auprès des populations. On s’est contenté d’expliquer le symbole qu’il représente pour un règlement de conflit, sans explorer les différentes dimensions de sa substance. Alors que ce n’est pas qu’un accord pour un cessez-le-feu. C’est surtout un projet de développement. Cet aspect n’a pas été vulgarisé et ce que les Maliens retiennent finalement, ce n’est qu’un cessez-le-feu signé sous la contrainte d’un État trop faible pour gagner la guerre à l’époque ».
En plus de la question de l’appropriation de son contenu, avance-t-elle, « c’est un accord signé pour mettre fin à la guerre et non pour faire la paix. Sur ce point, pour faire justice, c’est un reproche général sur la majorité des accords de paix signés dans le monde. Ils sont élaborés par des parties souhaitant vite un cessez-le-feu et ne prenant pas le temps de penser la paix. Le dernier facteur, ce sont les médiateurs. À ce niveau, je rejoins le discours officiel des autorités de transition : il y a eu trop d’intermédiaires entre Maliens. La médiation internationale a pris le pas sur celle nationale. C’était une grande faille de l’Accord d’Alger ».
Cette médiation était composée « d’organisations internationales engagées dans le recouvrement de la paix au Mali – Cédéao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), Union Africaine (UA), ONU (Organisation des Nations Unies), Union européenne (UE), Organisation de la coopération islamique (OCI) – et des États voisins du Mali dont le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et le Tchad », détaille le chercheur malien en relations internationales Dr. Abdoul Sogodogo, dans un article de mars, pour The Conversation.

L’un des défis de sa mise en œuvre, dès le départ, aura été la question du DDR (désarmement, démobilisation et réintégration) des combattants des parties signataires non étatiques. Pour M. Ambacane, « il y a eu notamment un sérieux problème au niveau du désarmement et de la réinsertion de ceux-là qui ont pris les armes contre l’État central. Aussi, le départ de la Minusma a apporté un coup fatal à l’application de cet accord sans oublier les différentes attaques des bases maliennes. Ce qui a certainement mis de l’huile sur le feu, c’est l’attaque barbare contre le bateau ‘’Tombouctou’’ (le 7 septembre 2023, aux alentours de Gourma-Rharous dans la région du même nom, du navire civil réduit en cendres, NDLR) ».
« Le conflit malien est, en partie, un héritage de la colonisation française »
Pour mémoire, le Mali a connu depuis son indépendance (1960) une multitude d’accords de paix, à la suite de différentes révoltes et rébellions mettant en cause la nature même de l’État. La première révolte est survenue, entre 1963 et 1964, « dans un contexte de construction de l’État moderne socialiste monopartisan » sous le régime de Modibo Keïta, a écrit en 2018 dans une étude feu Dr. Nafett Keïta.
Au crépuscule du règne de son tombeur, le général Moussa Traoré (GMT), en 1990, ce fut une « rébellion parallèle à l’État malien en pleine mutation du fait des revendications politiques intérieures portant sur l’instauration d’espaces de liberté, de la démocratie et du multipartisme ». Cette rébellion est sanctionnée entre le 6 janvier 1991 et le 11 avril 1992, respectivement par la signature de l’Accord de Tamanrasset et du Pacte National, tous deux toujours sous l’égide de l’Algérie. Dans le cadre de l’accord de 1992, il y eut également « la facilitation de personnalités fortes » comme l’ancien ministre et sénateur français Edgar Pisani ainsi que le diplomate mauritanien Ahmed-Baba Miské (homme politique, fervent militant sarahoui…), auteur de l’essai de recherche en histoire « La décolonisation de l’Afrique revisitée. La responsabilité de l’Europe » (éd. Karthala, Paris, 2014).

Entre 1994 et 2000, sous le magistère du premier président malien démocratiquement élu, Alpha Oumar Konaré (AOK), rappelle toujours le document du philosophe et anthropologue malien Dr. Naffet KEITA, « une série de révoltes et de désertions locales (…) éclatèrent, motivées selon les acteurs, d’un côté, par le retard enregistré dans l’application du Pacte National et, de l’autre, par les frustrations exprimées par certains groupes ethnoculturels des régions dites du Nord du pays qui reprochent au gouvernement de faire la part belle aux mouvements ‘’arabo-touareg’’ armés au détriment de la population sédentaire ; la scission ou fusion des mouvements armés suivant des clivages tribaux et la constitution de groupes d’autodéfense ethnoculturels ». Ces dernières révoltes ont été gérées, au plan politique, « par des solutions dessinées sans une base d’accords explicites ».
En 2006 sous la présidence du « soldat de la démocratie », Amadou Toumani Touré (ATT) – qui a renversé le général Moussa Traoré et conduit la transition de 1991 avant d’être lui-même chassé du pouvoir en 2012, à quelques semaines de la fin de son deuxième quinquennat, par le capitaine bombardé général 5 étoiles Amadou Aya Sanogo –, une nouvelle rébellion éclata. Elle a été menée par l’Alliance pour la Démocratie et le Changement (ADC), qui « estime que l’État a favorisé la gestion des affaires publiques par les tribus intermédiaires, aux dépens de certaines notabilités de Kidal et d’autres grandes tribus Touareg et Arabes (l’omniprésence des Kel Affala/Ifoghas dans les postes électifs nationaux et locaux ne serait pas justifiée, car manquant de transparence et ne respectant ni les règles d’équité entre candidats, ni la liberté de choix des élus). La signature de l’Accord d’Alger, supposée apporter des corrections utiles, n’a pas pu éradiquer les clivages sociaux ni les reconfigurations tribales dans l’Adagh des Ifoghas (Kidal) », explique le défunt Naffet Keita dans « L’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger : entre euphorie ou doute, la paix en signe de traces ! », rapport réalisé pour FES (la fondation allemande Friedrich-Ebert-Stiftung). Pour le chercheur « les suites de cette rébellion ont probablement alimenté et amplifié celle plus récente de 2012 ».

Pour Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur à l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), « plusieurs facteurs expliquent la rupture de l’Accord de 2015 à l’instar des accords précédents négociés par l’Algérie », rappelant au passage que « le conflit malien est, en partie, un héritage de la colonisation française » en ce sens qu’ « en 1957, dans la mouvance de l’indépendance des anciennes colonies françaises en Afrique – à travers une pétition – des leaders Touareg ont réclamé le rattachement de l’Organisation commune des régions sahariennes (OCRS) à l’Algérie voire son indépendance ».
Selon le vice-doyen de la Faculté des Sciences Administratives et Politiques (FSAP) de Bamako, « l’accord ne touche pas aux racines du conflit, notamment la question épineuse de l’indépendance de l’Azawad », « le problème de fond n’étant pas traité, les acteurs se sont inscrits dans une logique d’instrumentalisation de l’Accord ». En plus, « les groupes armés signataires de l’Accord ont profité de la médiation et de l’Accord qui en a découlé pour obtenir la sympathie et le soutien du Qatar », renforçant par la même occasion « leur légitimité sur les territoires du Nord du pays dont ils avaient le contrôle en raison de l’absence de l’État dans cette zone », « l’Accord a souffert d’un manque de légitimité populaire », et « enfin, il semble que l’objectif de la médiation algérienne n’a jamais clairement été de parvenir à un accord considéré comme réaliste et potentiellement applicable ».

L’option du dialogue inter-malien, vers une paix durable ?
Le 31 décembre 2023, à l’occasion du traditionnel discours de nouvel an, le président de la transition a ainsi annoncé, quasiment à la surprise générale, la mise en place d’un dialogue inter-malien. « J’ai pris l’option de privilégier l’appropriation nationale du processus de paix, en donnant toutes ses chances à un dialogue direct inter-malien pour la paix et la réconciliation afin d’éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Cette décision, que nous avons déjà partagée avec les différents acteurs nationaux et internationaux concernés dès l’entame du retrait de la Minusma (1er juillet au 31 décembre 2023, NDLR), exige (…) que nous nous donnions la main afin de réconcilier notre pays et assurer la cohésion nationale », a déclaré, dans son message télévisé à la nation d’environ 17 minutes, le tombeur du président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK).
Le président de transition a néanmoins prévenu, comme IBK en son temps et d’autres, que « l’unicité de l’État, la laïcité de l’État et l’intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion ». Pendant les premiers jours qui ont suivi cette annonce, son gouvernement a multiplié les cadres d’échanges autour de la décision, notamment avec les légitimités traditionnelles dont leur rôle dans la gouvernance a été institutionnalisé dans la Constitution de juillet 2023. De l’avis d’Ousmane Souleymane Ambacane, auteur de « La révolte de la poésie », « tous les acteurs doivent prendre part au dialogue inter-malien en ce sens que le mal est national. Cependant, il faut accorder une oreille attentive à ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays, connaître les motifs réels et trouver des solutions. Pour cela, aucun acteur ne doit être exclu ».
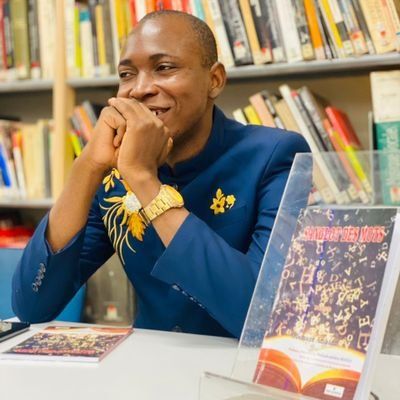
L’analyste Fatim D., intéressée notamment par les questions de gouvernance locale et de géopolitique, rebondit dans le même sens mais avec plus de détails : « Il s’agit de tous les acteurs en particulier les autorités publiques, les légitimités traditionnelles qui ont également un grand rôle à y avoir, les acteurs économiques car ils ont beaucoup à dire autant sur l’impact de ce conflit que l’économie nationale, etc. Et il faut que la jeunesse ait une grande place au sein de ce dialogue car, pour l’essentiel, le conflit prend racine avant leur naissance et ils en subissent les conséquences sans réellement savoir pourquoi. La paix sera défendue par la voix de cette jeunesse dont l’avenir est hypothéqué par un conflit dont ils n’ont pas la responsabilité de la naissance ».
Dans son rapport Afrique du 20 février 2024, « Nord du Mali : revenir au dialogue », l’International Crisis Group (ICG) a soutenu que « malgré l’abandon de l’Accord d’Alger, la décision des autorités de transition d’ouvrir un dialogue inter-malien, quelques semaines après la reprise de Kidal, redonne une chance à la négociation plutôt qu’à la poursuite des affrontements ».
Le colonel Assimi Goïta a, par décret du 31 janvier, désigné les membres du Comité de pilotage du dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation nationale. Il est présidé par l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga (2004 – 2007). Ce dernier a également été, avec l’ex-médiateur de la République Baba Akhib Haïdara et l’altermondialiste Aminata Dramane Traoré, membre du Triumvirat. Un comité à trois mis en place en 2019 par l’ex-chef de l’État Amadou Touamani Touiré décédé le 16 janvier 2022, pour faciliter les travaux du Dialogue national inclusif (Dni), organisé en décembre de l’année 2019.
Dans le nouvel organe, Ousmane Issoufou Maïga est secondé par l’universitaire et historien à la retraite Jean-Bosco Konaré (ancien ministre), qui assure la vice-présidence, et de deux rapporteurs. Ce comité est composé initialement de 140 membres aux profils variés au vu de la liste consultée par nos soins. Avec la mort de son porte-parole Adama Samassékou, linguiste et politique aussi ancien ministre de l’Éducation nationale, le 23 février, ils sont pour le moment réduits à 139 associés.
Entre autres participants au dialogue inter-malien (Dim), selon nos informations, il y a les représentants des associations de jeunesse, de femmes, de personnes vivant avec un handicap, des légitimités et autorités traditionnelles, de confessions religieuses (musulmanes, catholiques, protestantes), de chasseurs traditionnels, des mairies, des sous-préfets, des organisations socioprofessionnelles.

Dans le document instituant sa création auprès du président en treillis de la transition, décret du 26 janvier, il est indiqué que « le Comité de pilotage est chargé de la préparation et de l’organisation » de la nouvelle concertation nationale. À ce titre, « il élabore les termes de référence du dialogue et les soumet à la validation d’un atelier national qu’il organise, assure la programmation, la coordination et la supervision des différentes activités du dialogue à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national, conçoit et veille à la mise en œuvre du plan de communication, élabore le rapport final du dialogue et le rapport d’exécution de sa mission ».
« C’est tout le défi lorsque l’on sait combien d’initiatives de dialogue inter-malien ont été initiées au cours de l’Histoire de notre jeune État, sans véritablement être inclusives »
Le 5 février, les membres de la nouvelle instance ont été installés dans leurs fonctions. Près d’un mois plus tard, le 5 mars, ils ont remis au colonel Goïta leur rapport général de l’atelier national de validation des termes de référence. Tama Média n’est pas parvenu à obtenir la version originale remise au chef de l’État : « Honnêtement, c’est notre président du comité qui a le rapport dont il a remis copie originale au colonel Assimi Goïta. Les autres membres ne l’ont pas. Son contenu est réservé au président de transition », a confié sous couvert d’anonymat une des sources approchées. « Par contre les documents (termes de référence – TDR, cinq fiches thématiques et règlement intérieur) sont des documents publics dont les copies physiques nous ont été remis car on les a élaborés ensemble. La version électronique est normalement sur notre site web », a-t-elle signifié avant de nous partager lesdits textes. Dans ces fiches, effectivement consultables sur le site internet malidialogue.ml, au moment de la rédaction de cet article, les cinq thématiques choisies, avec chacune une note introductive, sont par ordre de numérotation : « Paix, réconciliation nationale et cohésion sociale » (neuf pages), « Questions politiques et institutionnelles » (neuf pages), « Économie et développement » (neuf pages), « Aspects sécuritaires et défense du territoire » (sept pages) et « Géopolitique et environnement international » (onze pages).
L’accord qui accouchera de cette nouvelle concertation nationale sans médiation internationale sera-t-il être plus « réaliste(s) et potentiellement applicable(s) » que l’Accord d’Alger de 2015 qui aura aussi été longtemps considéré par certains comme gage de stabilisation dans le pays avant d’être regardé comme moribond ? « Oui. Mais, à condition que de ce nouvel accord naisse un dialogue véritablement inclusif. C’est tout le défi lorsque l’on sait combien d’initiatives de dialogue inter-malien ont été initiées au cours de l’Histoire de notre jeune État, sans véritablement être inclusives », répond avec nuance Fatim D. sous couvert d’anonymat pour des raisons jugées professionnelles. « S’il est fait avec sincérité et honnêteté, ce dialogue pourrait être une belle alternative, ajoute Ousmane Souleymane Ambacane. Sa réussite dépendra surtout de l’engagement et de la volonté des Maliens. Rédiger un bel accord est une chose et son application en est une autre. Il ne servira à rien d’établir un bon accord s’il va finir dans le tiroir. »

Dans sa note d’analyse, l’ICG estime pour sa part que « les autorités devraient tirer les leçons de l’échec de l’Accord d’Alger, en veillant notamment à rendre ce nouveau processus plus inclusif afin de trouver les solutions requises pour stabiliser le nord ». Cela passe par l’implication des acteurs politiques, de la société civile et des légitimités traditionnelles, mais également des membres du CSP, et éventuellement des djihadistes. « Le gouvernement devrait faire un effort particulier pour inclure le plus grand nombre de femmes et de jeunes au dialogue inter-malien », ajoute l’International Crisis Group dans son étude du 20 février 2024. Pour beaucoup d’observateurs et spécialistes, le dialogue inter-malien s’est présenté initialement en une belle opportunité pour asseoir des bases solides d’une paix durable, avec tous les défis que cela nécessite, dans un pays ouest-africain et sahélien meurtri par les conflits armés successifs depuis son indépendance, outre sa longue tradition de coups d’État. Mais les derniers événements en date (suspension des partis politiques et activités à caractère politique, les refus de participation de certaines formations politiques au dialogue inter-malien, ainsi que les rapports de la phase communale qui s’est déroulée du 13 au 15 avril, etc.) laissent croire à certains que ce rendez-vous est finalement utilisé par ses initiateurs pour s’éterniser davantage au pouvoir, en légitimant notamment une deuxième prorogation de la durée de la transition qui se profile à l’horizon – la première prolongation est arrivée à terme le 26 mars dernier –, mais aussi une éventuelle candidature du colonel Assimi Goïta à l’élection présidentielle post-transition dont la tenue ne semble pas encore à l’ordre du jour.